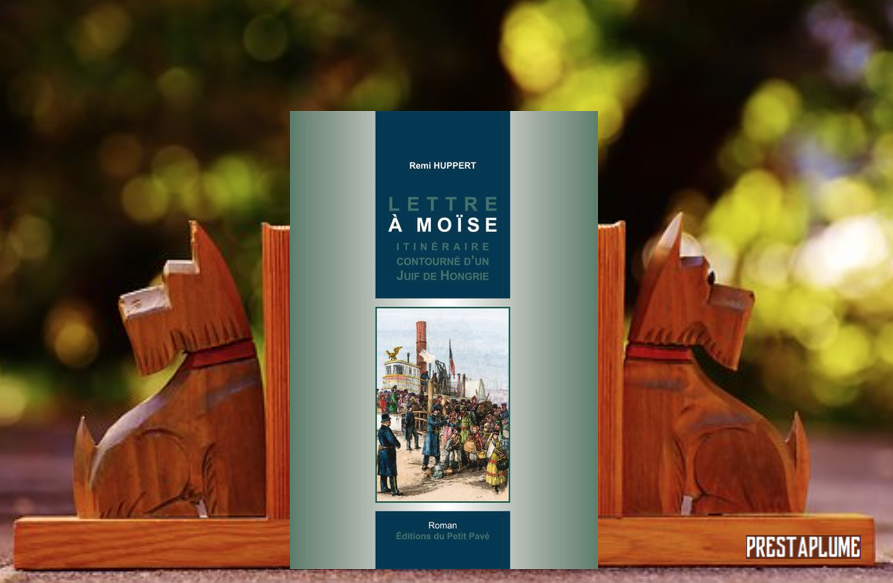
Par Ada Shlaen
[28 mai 2024]
Avez-vous remarqué que lorsque vous entrez dans une librairie, même si vous y allez avec un but précis et des titres, soigneusement notés sur une feuille, l’environnement vous incite à changer vos plans, à prendre un volume qui figure sur la liste des « meilleures ventes » et qui se trouve à la portée de votre main, dans des piles multicolores, placées bien en évidence. C’est si facile d’en tirer un qui vous promet le dépaysement, loin de vos soucis quotidiens !
Mais il m’arrive souvent de choisir des livres dont on parle moins et qui me procurent beaucoup de plaisir et le rare sentiment d’être un découvreur. Parfois je suis les conseils de mes proches, la Lettre à Moïse1 de Remi Huppert, dans lequel il évoque le destin de son grand-père, un Juif hongrois qui a beaucoup « bourlingué » par le monde, avant de s’installer sur ses vieux jours à Paris, fait partie des titres suggérés par une amie qui me signale souvent des livres, des films, des spectacles appréciés par elle. Évidemment je lui rends la politesse et nous pouvons partager ainsi nos trouvailles.
Dès le début, ce livre captiva mon attention, surtout grâce à l’évocation des visites du héros chez son grand-père. Par exemple le passage suivant :
« Une valise reposait sur l’armoire, joliment patinée, […] c’était la valise d’un passager en transit qui, débarquant d’un port inconnu avant d’aller ailleurs, logeait à l’hôtel »
éveilla en moi des souvenirs très lointains et pourtant toujours vivants. Comme il se trouve au début du volume, j’avais vraiment l’envie de lire la suite !
Sur la quatrième de couverture j’ai trouvé une brève biographie de l’auteur qui semblait assez contrastée. Il était diplômé d’HEC et avait effectué plusieurs missions auprès de la Banque mondiale ou l’UNICEF. Or parallèlement, il pouvait être défini comme un vrai littéraire, amoureux de la poésie et de la musique qu’il pratique depuis ses jeunes années.
Plusieurs titres de ses romans suggéraient des lointains voyages. Ses héros parcourent le monde : Léningrad, Grenade, Saïgon, la Chine, les États-Unis … Mais l’éloignement géographique ne signifie pas que l’auteur se contente d’une recherche facile de l’exotisme. Dans ce cadre lointain, ses personnages auront à faire leurs preuves et il n’est pas dit qu’ils en sortiront vainqueurs.
Une autre évidence s’imposait déjà au premier coup d’œil sur les titres alignés : l’importance de la musique. On pourrait même classer les livres de Remi Huppert en deux catégories principales.
J’appellerai la première « musicale », qui regroupe des romans dédiés aux musiciens, réels ou imaginaires. Je pense surtout à La partition de l’exil, où il évoque le compositeur franco-polonais Alexandre Tansman, qui a laissé un bel héritage musical qu’on redécouvre actuellement, après une période d’effacement passager. Ensuite viendrait le roman Destin d’un juif de Chine qui présente la tragédie du jeune pianiste Semyon Kaspe, originaire de la communauté juive de Harbin, assassiné par des Russes antisémites qui se sont fixés en Mandchourie après le coup d’État des bolchéviks de novembre 1917. On pourrait inclure dans cette série le roman « Un trio vraiment très swing », avec ses trois personnages imaginaires, une pianiste sud-coréenne, un jazzman d’Alabama et un saxophoniste juif de Chicago, réunis par l’amour du jazz.
Une seconde série d’ouvrages parle de la recherche de ses racines, de l’héritage familial et culturel. Nous le voyons dans le roman autobiographique La lettre à Moïse, consacré à l’histoire de sa famille, mais aussi dans Mourir à Grenade qui raconte l’histoire d’un homme, obligé de quitter l’Espagne pendant la guerre civile et qui revient dans sa patrie après des décennies pour la redécouvrir à l’orée de sa mort. Je pense par ailleurs que ces deux thèmes sont souvent entremêlés dans la plupart des romans.
Ne voulant pas lasser mes lecteurs par une approche trop répétitive, j’ai préféré m’attacher à des textes qui me semblaient particulièrement révélateurs. Il s’agit d’un choix tout à fait personnel, motivé par mes propres souvenirs ou ressentis.
Mais je serai heureuse de pouvoir jouer un rôle de « passeur » qui vous invite au dépaysement et à un certain retour sur soi.

Dans la série « musicale » la biographie romancée d’Alexandre Tansman La partition de l’exil présente les différentes facettes du talent de l’auteur qui y suit le cheminement d’un personnage réel, écartelé entre plusieurs langues, plusieurs pays, plusieurs cultures… Nous y assistons aux événements historiques avec des personnages réels, bien plantés dans leur cadre de vie. L’auteur qui a l’étoffe d’un historien rigoureux ou d’un bibliographe accompli, arrive à redonner vie à ces épisodes lointains qui retrouvent leur éclat sous les yeux mêmes des lecteurs.
Le compositeur Alexandre Tansman né en 1897 à Łódź2, quitta la Pologne très jeune, pour passer la majeure partie de sa vie en France où il mourut en 1986. Au moment de sa naissance son pays natal était effacé des cartes en tant qu’État indépendant. Depuis 1795, partagé entre trois envahisseurs la Russie, la Prusse et l’Autriche, il subissait une sorte de non-existence. Les Polonais étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, mais le sort le plus dur échut à la nombreuse communauté juive, qui devait supporter des brimades bien plus fortes que leurs compatriotes catholiques.

Né à Lodz qui se trouvait alors sur le territoire administré par les autorités russes, Alexandre faisait néanmoins partie des privilégiés. Sa ville natale, surnommée le Manchester polonais était alors en train de devenir un important centre industriel. À Lodz, des Juifs riches, assez nombreux, jouaient un rôle important, ce qui est montré avec des images saisissantes dans le film du grand metteur en scène polonais Andrzej Wajda, tourné d’après le roman de Władysław Reymont, la Terre de la grande promesse3. En général dans ces familles juives, des enfants recevaient une bonne éducation. C’était le cas d’Alexandre ; né dans un milieu aisé, avec des parents mélomanes, qui suivaient attentivement leur progéniture et qui parvenaient à développer leurs dons. Il avait une sœur aînée qui étudia au Conservatoire de Berlin, des cousins à Moscou proches d’Alexandre Scriabine et chez lesquels il avait l’occasion d’entendre des concerts, dirigés par Serge Koussevitzky4 qui venait de fonder son propre orchestre qui faisait déjà des tournées réputées dans toute l’Europe. Ces séjours moscovites lui permirent d’apprendre le russe, et ainsi, peu à peu il deviendra un vrai polyglotte, en maîtrisant au moins cinq langues : le polonais, le russe, l’allemand, le français et l’anglais. Alexandre commença à composer dès son plus jeune âge et de plus fut un très bon élève. Malgré l’existence d’un numerus clausus, le jeune garçon obtint brillamment son baccalauréat et put s’inscrire à l’université de Varsovie où il suivit plusieurs cursus parallèles : le droit, la philosophie, des études musicales au Conservatoire qui portait évidemment le nom de Frédéric Chopin qui l’avait fréquenté entre 1826 et 18295.
Au lendemain du traité de Versailles, la Pologne retrouva son indépendance, mais la vie des Juifs présentait toujours les mêmes embûches. Le jeune compositeur en fit rapidement une expérience désagréable ; ayant participé sous des pseudonymes au premier concours de composition, organisé dans la Pologne indépendante, il fut déclaré vainqueur à trois reprises, dans trois catégories différentes. Cette prouesse provoqua une vraie campagne de dénigrement à cause précisément de ses origines.
Comme de très nombreux jeunes artistes juifs, Alexandre choisit alors l’exil.
D’une manière tout à fait symbolique son visa de sortie lui fut accordé par Ignacy Paderewski6, le grand virtuose de cette époque, qui occupait alors le poste du premier ministre de ce jeune État, réapparu sur la carte de l’Europe.
L’auteur suit son héros à Paris des « années folles » quand la capitale française accueillait de nombreux artistes de l’Europe de l’Est, chassés par la vague révolutionnaire qui avait recouvert la Russie et une bonne partie de l’Europe Centrale entre 1917 et 1921. On peut dire qu’Alexandre Tansman arrive au bon moment à l’époque où le milieu artistique était très ouvert et donnait sa chance à celui qui savait la saisir. Il faut aussi souligner l’importance de sa rencontre avec Maurice Ravel qui sut le mettre en garde contre la facilité qui guette souvent des jeunes personnes talentueuses trop sûres d’elles.
Les mots que l’auteur met dans la bouche du compositeur, expérimenté et aguerri, ont sûrement produit leur effet :
« Il vous faut apprendre la précision. La concision vous fait défaut. Taillez, retranchez, même à regret… »
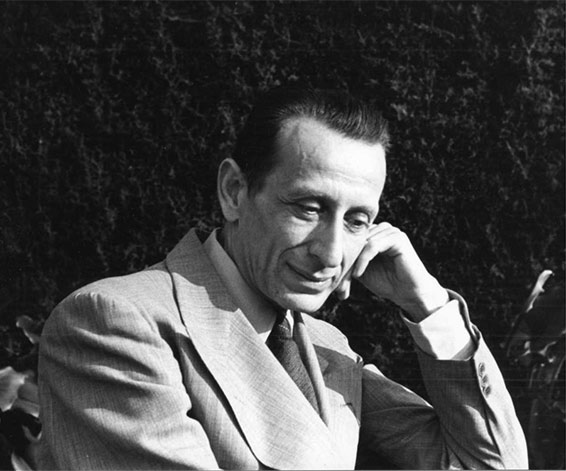
Après les premiers mois assez durs dans la capitale française où le jeune homme devait même travailler comme emballeur à la Villette, il parvint peu à peu à s’imposer dans le monde musical et favorisa au passage la musique polonaise, toujours attaché à la tradition romantique, dans la modernité. Ainsi Alexandre Tansman resta en France dans la période de l’entre-deux guerres, en recevant à la fin des années 1930 sa naturalisation. Sans aucun doute ces années furent fécondes pour lui ; il composait beaucoup, en approfondissant certains thèmes, inspirés par la musique populaire polonaise et en introduisant dans sa musique des thèmes nouveaux d’inspiration juive ou orientale. C’était aussi la période riche en tournées très lointaines : États-Unis, Asie où il sera reçu par l’empereur du Japon et Ghandi lors de son passage par les Indes.
Sa vie privée était aussi heureuse grâce à son mariage avec la pianiste Colette Cras qu’il épousa en 1937. Tout semblait alors lui réussir, malgré des signaux inquiétants que les Européens essayaient d’ignorer. À Berlin après l’arrivée au pouvoir du parti national-socialiste d’Adolf Hitler le nom d’Alexandre Tansman, comme celui de son compatriote, le pianiste Arthur Rubinstein, né comme lui à Lodz en 1887, se retrouva sur la liste d’artistes considérés comme appartenant à l’Entartete Kunst (Art dégénéré).
Ce n’était que le prélude à des événements bien plus tragiques qui ensanglanteront bientôt toute l’Europe. Le 1 septembre 1939 l’Allemagne nazie attaque la Pologne, qui connaît alors son quatrième partage, symbolisé par l’infâme pacte, signé par Joachim von Ribbentrop et Viatcheslav Molotov quelques jours avant cette invasion. Le compositeur aura encore le temps, en 1940, de rendre hommage aux « Défenseurs héroïques de Varsovie » parsa Rhapsodie polonaise, mais cette œuvre sera créée aux États-Unis où Alexandre Tansman et sa famille s’exileront en 1941 grâce à l’aide de plusieurs personnalités éminentes comme Charlie Chaplin, Arturo Toscanini, Serge Koussevitzki, toujours fidèle et amical, Yascha Heifetz et bien d’autres.
Cet exil américain permit au compositeur de resserrer ses liens d’amitiés avec de nombreux artistes européens qui avaient trouvé refuge aux États-Unis. Il deviendra même très proche d’Igor Stravinski qui avait aussi pu rejoindre les États-Unis en 1940. Tous vivaient alors dans l’appréhension des nouvelles qui parvenaient difficilement de l’Europe occupée. Certains de ces réfugiés restèrent après la guerre en Amérique, mais dès 1946 Alexandre Tansman revint en Europe où il continuera son œuvre pendant encore plus de quarante ans.
Il décède le 15 novembre 1986 en laissant un héritage artistique très riche et varié.
Un artiste est rarement pleinement satisfait de son œuvre, mais dans le cas d’Alexandre Tansman on ne peut que l’admirer. AS♦

Ada Schlaen, MABATIM.INFO
(À suivre)
1 Édition du Petit Pavé, 2021
2 En général ce nom est orthographié en français Lodz sans signes diacritiques caractéristiques de l’orthographe polonaise
3 Andrzej Wajda (1926-2016) le grand cinéaste polonais, une vraie légende du cinéma mondial, a réalisé en 1975 le film La terre de la grande promesse d’après le roman La Terre promise de Wladyslaw Reymont, prix Nobel de littérature en 1924 dans lequel il évoque cette transformation de Lodz.
4 Serge Koussewitzki (1874-1951) Il commença sa brillante carrière bien avant la révolution russe de 1917. Ensuite il aidait les jeunes compositeurs, souvent ses élèves comme Leonard Bernstein. Directeur musical de l’Orchestre symphonique de Boston pendant 25 ans, Serge Koussevitzky fut aussi un grand mécène, et commanda un nombre considérable de partitions aux compositeurs. Il est ainsi à l’origine de plusieurs chefs-d’œuvre du XXᵉ siècle !
5 Le Conservatoire de Varsovie fut créé en 1810.
6 Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) était une personnalité incontournable de la vie culturelle polonaise de la fin du XIXe et le début du XXᵉ. Il se fit connaître tout d’abord comme pianiste remarquable. Ensuite il devint un mécène et philanthrope efficace. Il décida alors d’ouvrer à l’indépendance de la Pologne. Après la première guerre mondiale il sera à la tête du nouveau gouvernement et occupera le poste de ministre des Affaires Étrangères. Il représentera la Pologne à la Conférence de la paix à Paris. À ce titre, il signa le traité de Versailles le 28 juin 1919 et celui de Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre de la même année qui consacreront l’indépendance du pays après 124 ans marqués par la disparition du pays de la carte de l’Europe.
En savoir plus sur MABATIM.INFO
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.



Merci pour ces informations précieuses car les bons livres nous permettent de tenir le coup et de ne pas désespérer de l’humanité, particulièrement lorsque le monde va si mal !
J’aimeJ’aime
[…] Article précédent :Itinéraires croisés : un juif en Europe (1/2) […]
J’aimeJ’aime
Angel Wagenstein qui malgré son nom ashkénaze est un juif séfarade: Le Pentateuque ou les cinq livres d’Isaac, Abraham le poivrot, loin de Tolède, Adieu Shanghai.
J’aimeJ’aime