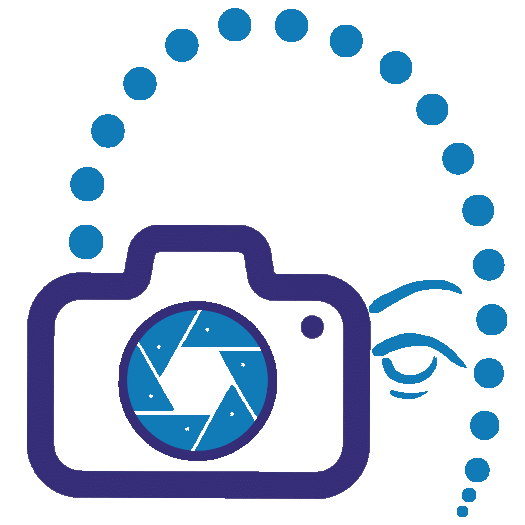Par Simone Rodan,
[31 décembre 2025]
Partout en Iran, des commerçants ont baissé leurs rideaux métalliques – puis sont descendus dans la rue. Quand le bazar ferme, ce n’est jamais seulement une question d’argent. En Iran, le bazar a toujours été plus qu’un lieu de commerce. C’est un lien social, un ballast politique, un stabilisateur.
Pendant des décennies, il a absorbé des chocs qui auraient pu faire vaciller le système. Son silence valait consentement. Beaucoup de ses acteurs sont conservateurs, prudents, méfiants face à toute forme de rupture.
Ce silence a disparu.
Les manifestations qui se propagent aujourd’hui dans les villes iraniennes sont déclenchées par l’effondrement économique, oui – mais quiconque écoute la rue sait qu’il ne s’agit pas d’une révolte sur les prix.
Les slogans racontent autre chose. On y crie que la République islamique est finie. On y vise le Guide suprême. On y réclame la restitution d’un pays confisqué.
Des décennies de sanctions ont vidé l’économie de sa capacité productive. Le coût des guerres par procuration – Hezbollah, milices en Syrie et en Irak, Houthis, soutien au Hamas – a drainé les finances publiques sans produire autre chose que l’isolement et l’humiliation.
La corruption a proliféré : des entreprises liées aux Gardiens de la Révolution dominent des secteurs entiers, aspirant les richesses pendant que les infrastructures se dégradent. Pendant ce temps, ceux qui avaient des compétences ou des alternatives sont partis.
Ce qui reste, c’est une économie saturée de sanctions, gangrenée par la corruption, épuisée par les aventures extérieures, tentant de maintenir à flot un pouvoir profondément impopulaire. Il n’y a plus de réserve.
Cela compte. Parce que l’Iran a déjà protesté. Souvent. Et à chaque fois, le régime a réprimé, et s’est rassuré en expliquant qu’il s’agissait d’explosions limitées : les étudiants, les élites, les femmes, les pauvres, les provinces. Chaque vague pouvait être isolée, écrasée – souvent plus violemment que la précédente – puis oubliée.
Ce que nous voyons aujourd’hui est peut-être d’un autre ordre.
Une accumulation ? Elle porte la mémoire de chaque tentative avortée de changer le système de l’intérieur.
– En 2009, des millions d’Iraniens ont manifesté pacifiquement après une élection volée, convaincus que le vote avait encore un sens. Ils portaient du vert. Ils ont été battus, emprisonnés, réduits au silence.
– En 2017 et 2019, la contestation est revenue, nourrie par la détresse économique. Émeutes de la faim. Colère autour du carburant. Révolte des périphéries. La réponse fut encore plus sanglante. Des centaines de morts.
– En 2022, après la mort de Mahsa Amini, quelque chose de plus profond s’est brisé. Des femmes ont arraché leur voile. Des adolescents ont interpellé le pouvoir frontalement. « Femme, Vie, Liberté ». La répression a été féroce, mais la peur ne fonctionnait plus de la même manière. Le régime avait été vu à nu, dépouillé de toute prétention à la légitimité.
Chaque soulèvement a échoué pris isolément.
Mais ensemble, ils ont peut-être produit quelque chose de bien plus dangereux pour un système autoritaire qu’une révolte unique : une société qui n’a plus d’illusions.
Cette érosion des illusions a rouvert un espace que la République islamique avait passé des décennies à effacer : la possibilité que l’Iran ait existé politiquement avant 1979 – et puisse exister à nouveau sans domination cléricale.
Pour la première fois depuis une génération, les slogans évoquant les Pahlavi ne sont plus confinés à la nostalgie ou à l’exil. Ils sont scandés à l’intérieur du pays, par des Iraniens qui n’ont jamais vécu sous la monarchie.
Il ne s’agit pas nécessairement d’un appel à la restauration.
C’est le rejet du mensonge fondateur du régime : l’idée que l’histoire commencerait avec la révolution, que tout ce qui précède ne serait que corruption et décadence, et qu’aucune identité politique iranienne ne serait légitime en dehors de la République islamique. Le régime le comprend parfaitement. Les symboles deviennent dangereux lorsque les systèmes sont épuisés : ils permettent d’imaginer un « après » avant même d’en dessiner les contours.

Et cette fatigue s’exprime au moment même où la posture extérieure du régime s’effondre en même temps que sa légitimité intérieure.
Les forces par procuration censées garantir sa puissance sont affaiblies :
– Le Hezbollah a été sérieusement dégradé.
– La Syrie d’Assad, pivot du dispositif régional iranien, n’est plus.
– Le Hamas est exsangue.
Le programme nucléaire, longtemps présenté comme un symbole de puissance nationale, est devenu une source d’isolement et de vulnérabilité. Pendant des décennies, le régime a expliqué aux Iraniens que leurs sacrifices servaient une grande stratégie régionale. Ce récit n’est plus crédible. Le pouvoir apparaît désormais faible – engagé dans des guerres que sa population ne soutient pas et ne veut plus payer.
« Ni Gaza, ni le Liban, notre vie pour l’Iran », scandent les manifestants.
Reste la question décisive : est-ce suffisant ?
Les systèmes autoritaires s’effondrent lorsque la peur change de camp. Mais ce basculement suppose une convergence.
Une défiance sociale durable, qui ne se dissipe pas. Des grèves qui paralysent. Des foules qui grossissent au lieu de se réduire. Des protestations qui cessent de demander et commencent à anticiper une fin.
C’est là que la perturbation économique devient une force politique. Les enseignants, les ouvriers du pétrole, les routiers ont déjà fait grève. Mais si l’Iran des classes intermédiaires s’y joint
– médecins refusant de travailler dans les hôpitaux du régime,
–ingénieurs quittant les chantiers,
– fonctionnaires cessant simplement de venir,
… alors la capacité de l’État à fonctionner se grippe. Le bazar qui ferme est un signal fort. Les étudiants qui rejoignent le mouvement le renforcent. On verra pour la suite.
Vient ensuite l’hésitation au sein des forces de sécurité. La République islamique survit parce que ses armes obéissent encore. Mais l’obéissance n’est pas infinie, et l’appareil coercitif n’est pas homogène. Les Gardiens de la Révolution sont idéologiquement engagés et économiquement liés au système. Les Bassidji sont jeunes, mal payés, issus des mêmes quartiers que ceux qu’ils répriment. L’armée régulière a été marginalisée et supporte mal la domination des Gardiens. La police est épuisée, sous pression, plongée dans la même crise économique que le reste de la société.
Les forces de sécurité ont des familles. Elles voient les mêmes images. Elles sentent quand un système vacille.
Lorsque des ordres ne sont plus exécutés, lorsque des unités se mettent en retrait, lorsque ne serait-ce qu’une force visible refuse de tirer, la répression cesse de fonctionner comme un instrument unifié. La question n’est pas de savoir si tout se fracture, mais si une fracture devient suffisamment visible pour autoriser les autres.
Enfin, il y a la rupture psychologique au sommet. Le pouvoir autoritaire repose sur un sentiment d’inévitabilité – la conviction que résister est inutile et obéir rationnel.
Quand cette conviction se fissure chez les élites, les clercs, les commandants, lorsque les responsables hésitent, disparaissent, préparent des issues, l’effondrement s’accélère. Pas lentement. Brutalement.
C’est là que le clergé joue un rôle clé. Le régime revendique une légitimité religieuse, mais Qom n’est pas monolithique :
- Certains clercs sont des croyants sincères.
- D’autres sont des pragmatiques qui ont composé avec le pouvoir sans vouloir mourir avec lui.
- D’autres encore sont discrètement désabusés – inquiets de la dérive du régime ou simplement épuisés par l’échec.
Lorsque des figures religieuses prennent leurs distances, suspendent leur soutien, ou laissent entendre que le système a perdu toute justification théologique, le régime perd plus qu’un appui politique. Il perd ce qui le distingue d’une simple dictature militaire.
La défection devient alors contagieuse. Le premier à rompre est courageux. Le dixième est prudent. Le centième est inévitable.

La loyauté cesse d’apparaître comme une force et devient un mauvais calcul.
Rien de tout cela n’est garanti. La République islamique est aguerrie à la répression. Elle a survécu à des moments qui semblaient définitifs. Mais quelque chose de fondamental a changé :
La société iranienne a d’abord demandé des réformes, puis de l’équité, puis de la dignité. Aujourd’hui, elle conteste la continuation même du système.
La communauté internationale ne décidera pas de l’avenir de l’Iran. Mais elle peut décider de ne pas s’y opposer et soutenir le peuple.
– La première responsabilité est de cesser de faire comme s’il s’agissait d’un conflit symétrique entre un régime et son peuple.
Ce n’est pas le cas. Les traiter comme moralement équivalents n’est pas de la neutralité. C’est une lâcheté présentée comme prudence.

Le soutien au peuple doit être clair. La couverture médiatique doit l’être aussi.
– Ensuite, il faut aider les Iraniens à rester connectés. Le pouvoir autoritaire prospère sur l’isolement. L’accès à Internet par satellite, les outils de communication sécurisés, le contournement de la censure ne sont pas des ingérences. Ce sont des lignes de survie. Chaque coupure doit être suivie d’une réponse extérieure.
– Troisièmement, la responsabilité doit cesser d’être abstraite. La répression repose sur l’anonymat et l’impunité.
Lorsque ceux qui ordonnent et exécutent la violence savent que les noms, les visages et les chaînes de commandement sont documentés, le calcul change.
– Quatrièmement, la défection doit devenir possible – et rationnelle. Ceux qui refusent de tirer, qui se retirent, qui rompent avec la répression doivent savoir qu’une issue existe.
À l’inverse, la fidélité à un système en déclin doit avoir un coût personnel : sanctions ciblées, gels d’avoirs, restrictions de déplacement. Les sanctions qui appauvrissent la population renforcent le régime. Celles qui rendent la vie des élites intenable renchérissent le prix de l’obéissance.
Le soutien doit parvenir directement à la société iranienne. La diaspora est nombreuse, structurée, connectée. Les ressources, la visibilité, la coordination peuvent renforcer les syndicats enseignants, les ordres professionnels, les médias indépendants, les organisations de défense des droits humains.

– Enfin, le monde extérieur doit résister à son réflexe le plus ancien : stabiliser le régime au nom de « l’ordre ».
Cette erreur a été commise à de multiples reprises – confondre le silence avec la stabilité, le calme provisoire avec la légitimité. Faire passer la diplomatie pour de la prudence alors qu’elle relève de la peur.
On invoquera la Libye, l’Irak. Oui, les révolutions sont dangereuses. Les transitions sont chaotiques. Personne ne devrait idéaliser l’effondrement.
Mais l’Iran n’est ni la Libye ni l’Irak. C’est un pays urbanisé, éduqué, doté d’une mémoire historique, de classes professionnelles, d’universités, de traditions juridiques et d’institutions civiques qui ont survécu à des décennies de répression.
C’est aussi une diaspora restée connectée et investie. L’opposition iranienne est fragmentée – monarchistes, laïcs, gauches, mouvements ethniques – mais cette pluralité est aussi le socle possible d’un pluralisme politique.
Les risques sont réels : fragmentation, verrouillage par les Gardiens de la Révolution, ingérences extérieures. Mais le risque de l’inaction l’est tout autant. C’est celui de confondre l’endurance avec la stabilité, de laisser la peur l’emporter par défaut, de préserver un système qui ne gouverne plus que par la force – et qui continue de déstabiliser son environnement chaque fois qu’il le peut.
Quand le bazar ferme, quand la rue annonce la fin du régime,
Quand la peur cesse de faire son travail, l’histoire est déjà en marche.
Le minimum, pour ceux qui regardent de loin, est de cesser de faire semblant de ne pas la voir. SR♦

Simone Rodan, Substack
En savoir plus sur MABATIM.INFO
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.