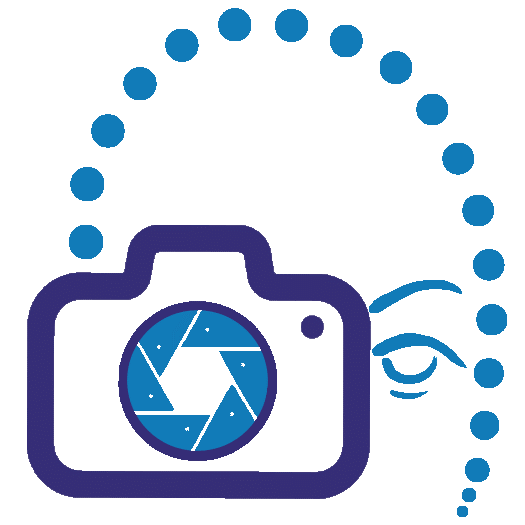Mars 2014
UNE INSTITUTION TRÈS ANCIENNE
La Kétouba est le contrat de mariage religieux. C’est l’acte qui doit être rédigé et signé, puis remis à la mariée immédiatement après le mariage, et sans lequel les époux ne peuvent vivre ensemble. On trouve dans nos sources une trace de l’institution de la Kétouba dès l’époque des Patriarches. Ainsi, Joseph qui avait épousé Osnatt en l’absence de son père Jacob, a tenu à montrer à son père la Kétouba qu’il avait écrite à sa femme, afin que Jacob accepte de bénir ses enfants nés de ce mariage(voir Rachi sur Béréchit 48-9).
Certains Décisionnaires pensent que l’institution de la Kétouba est une obligation Thoraïque, d’autres, dont Rambam, pensent qu’elle est une institution Rabbinique (voir Rambam Hil. Ichout ch. 10, hal.7). Le Talmud donne les motifs de cette institution et de son importance, notamment le fait d’engager le mari à payer les sommes de la Kétouba en cas de divorce, car il lui sera d’autant plus difficile de prendre cette décision. En d’autres termes, c’est une mesure anti-divorce (voir Guémara Ketoubot 82b).
De ce fait, si la Kétouba était perdue, on devait écrire une Kétouba de substitution, qui comporte un texte différent de la Kétouba habituelle. Dans ce cas, le mariage célébré reste valide, il faut simplement que le mari refasse, devant témoins, l’acte solennel d’acquisition en faveur de son épouse. Les témoins signeront alors l’acte nouvellement établi, daté du jour de leur signature et le remettront à l’épouse.
CONTENU DE LA KETOUBA
La Kétouba reprend l’acte de consécration de l’épouse par son époux en précisant la date hébraïque, le lieu et le prénom hébraïque des époux et de leurs pères respectifs. On mentionne également le statut religieux des époux (Cohen, Levi, Israël, converti) ainsi que la situation matrimoniale de la future épouse (célibataire, divorcée, veuve ou autre). Il y est également précisé que simultanément au consentement de l’épouse, son mari s’engage à la nourrir, la vêtir et l’entretenir et à lui payer un douaire (en hébreu mohar), ainsi que d’accomplir ses devoirs conjugaux. Le montant du douaire est de deux cent zouz si la mariée est célibataire, la moitié dans un autre cas.
La précision des informations concernant les époux (prénoms, célibat, conversion) portées sur la Kétouba est si importante qu’elle demande un examen préalable très minutieux, avec pièces à l’appui, sous peine d’invalider l’acte. Ainsi, les futurs mariés doivent se munir de plusieurs documents prouvant leur identité religieuse ainsi que leur filiation et la preuve de leur célibat ou non-célibat.
 Viennent ensuite les différentes sommes auxquelles s’engage l’époux envers l’épouse, et qu’il devrait lui régler en cas de divorce ou de veuvage. Il s’agit de la valeur estimée du trousseau que la mariée a fourni (en hébreu : nédounia), puis un augment consenti par le mari (en hébreu (tossefett kétouba). Il est en effet d’usage de rajouter une somme au minimum dû au titre du douaire. Ces deux sommes sont forfaitaires dans certaines communautés, dans d’autres, elles sont variables. En France, les formulaires de kétouba fournis par le Rabbinat comportent des sommes forfaitaires.
Viennent ensuite les différentes sommes auxquelles s’engage l’époux envers l’épouse, et qu’il devrait lui régler en cas de divorce ou de veuvage. Il s’agit de la valeur estimée du trousseau que la mariée a fourni (en hébreu : nédounia), puis un augment consenti par le mari (en hébreu (tossefett kétouba). Il est en effet d’usage de rajouter une somme au minimum dû au titre du douaire. Ces deux sommes sont forfaitaires dans certaines communautés, dans d’autres, elles sont variables. En France, les formulaires de kétouba fournis par le Rabbinat comportent des sommes forfaitaires.
La Kétouba va également stipuler que le mari hypothèque pour le paiement de ces sommes tous les biens qu’il possède, meubles ou immeubles, en engageant également ses héritiers en cas de veuvage, et qu’il a fait acte solennel d’acquisition (en hébreu : kiniane) de ces clauses, devant témoins, au bénéfice de la future épouse.
Cette manière d’engager le mari à hypothéquer ses biens, sans avoir à avancer une quelconque somme au jour du mariage, est une volonté expresse des Sages. Le but est en effet de laisser le paiement des sommes de la Kétouba peser sur le mari uniquement au moment du divorce, afin qu’il soit découragé de réaliser cette rupture.
Selon les usages locaux, la Kétouba pouvait également contenir des clauses particulières. Ainsi, à titre d’exemple, certaines Kétoubot stipulaient que le mari ne pouvait faire sortir son épouse de la terre d’Israël, si le couple venait à y résider, que si elle y consentait.
La signature de deux témoins va confirmer la validité de la Kétouba. Aussi, le choix des témoins doit être conforme aux exigences de la halakha (la loi religieuse), à savoir : n’avoir aucun lien de parenté avec les mariés, et être observant des lois de la Torah.
Si le plus souvent, la Kétouba est imprimée et remplie par le Rabbinat, certains s’attachent néanmoins à faire calligraphier par un scribe le texte généralement imprimé de la Kétouba, et éventuellement la faire décorer par un artiste. On trouve ainsi dans les anciennes Kétoubot tout un éventail de styles et de goûts, tant dans le texte que dans la présentation, reflétant les différentes cultures des régions où elles ont été établies.
On comprendra dès lors, que tant la rédaction de la Kétouba que la célébration d’un mariage ne peuvent être confiées qu’à une personne qualifiée pour ces actes hautement importants.
Une Kétouba établie par une telle personne sera de fait une preuve de la judaïcité des deux époux et de la validité du mariage, d’où la nécessité de la conserver précieusement.
Durant la cérémonie du mariage, l’officiant ou l’un des invités donne lecture de la Kétouba, puis la remet à la mariée. Cette dernière la confiera à ses parents ou la conservera au domicile conjugal.
Il est d’usage de faire précéder la lecture de la Kétouba par la lecture de versets contenant des bénédictions à l’adresse des mariés.