
Par Simone Rodan,
[25 janvier 2026]
Deux Américains sont morts à Minneapolis. La bataille pour savoir « ce qui s’est passé » dit tout de ce qui nous arrive.
Je fixe la même vidéo depuis ce matin.
Elle est granuleuse, filmée au téléphone, quarante-cinq secondes à peine. On distingue un homme au sol. Autour, des agents fédéraux. On entend des cris. Puis des coups de feu.
C’est la fin d’Alex Pretti. Trente-sept ans. Infirmier en réanimation au VA. Samedi matin, il est allé dans le sud de Minneapolis, là où les agents fédéraux de l’immigration mènent des raids depuis des semaines. Il n’est jamais rentré.
Quelques heures plus tard, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, est devant un pupitre :
« Terroriste domestique ». Elle affirme qu’il est arrivé armé, qu’il voulait « infliger un maximum de dégâts ». Qu’il a « réagi violemment » quand les agents ont tenté de le désarmer. Et que la fusillade était justifiée.
Un témoin, lui, dépose une déclaration sous serment devant un tribunal fédéral. Il raconte autre chose :
« Ils l’ont jeté à terre. Quatre ou cinq agents l’avaient au sol et ils se sont mis à tirer. Ils ont tiré tellement de fois. »
Les deux camps brandissent la vidéo.

Et c’est là que je reviens toujours au même point : je ne sais plus comment savoir ce qui s’est passé. Et je ne crois pas que vous le sachiez non plus...
Deux semaines plus tôt, dans le même quartier, des agents fédéraux avaient abattu Renee Nicole Good, trente-sept ans, mère de famille. Là encore, on a parlé très vite de « terrorisme domestique ». Les autorités locales disent qu’elle tentait de fuir une scène terrifiante. Les fédéraux affirment qu’elle a essayé de renverser un agent. Il existe aussi une vidéo. Elle ne tranche rien. Elle multiplie les lectures.
Après la mort de Pretti, les responsables locaux déposent une plainte : ils accusent les agents fédéraux d’avoir confisqué les téléphones de témoins, retenu des passants, ordonné à la police du Minnesota de quitter les lieux. Ils demandent à un juge d’empêcher le Department of Homeland Security de détruire des preuves. Et l’agence, bien sûr, enquête sur ses propres actes.
Je ne suis pas en train de vous dire quoi conclure de Minneapolis.

Je vous dis que les conditions mêmes qui permettent de conclure – pour n’importe qui, de n’importe quel côté – sont en train de s’effondrer...
Hannah Arendt avait vu venir quelque chose de cet ordre :
« Quand le mensonge se substitue aux faits assez longtemps », prévenait-elle, « nous perdons “le sens par lequel nous prenons nos repères” dans le monde : la distinction entre le vrai et le faux commence à se dissoudre. »
Vous n’avez pas besoin d’être convaincu d’un mensonge. Il suffit d’être fatigué. L’épuisement, voilà le danger. Pas tant que nous croyions la mauvaise histoire, mais que nous cessions de croire qu’une histoire peut être vraie ou fausse.
On ressort Orwell. On a raison.
Dans 1984, il avait un mot : la doublepensée.
Pas seulement croire à des mensonges – croire à des contradictions.

Savoir qu’une chose est fausse et l’accepter quand même. Regarder la même séquence et laisser la légende de votre camp faire le travail de voir à votre place...
Mais Orwell ne mettait pas seulement en garde contre les gouvernements.
Il mettait en garde contre ce qui se passe à l’intérieur de nos têtes quand nous cessons de faire l’effort de tenir la réalité ensemble.
L’État peut manipuler. L’algorithme aussi. L’influenceur aussi. La chambre d’écho aussi.

Et nous aussi – chaque fois que nous partageons sans vérifier, parce que « ça sonne vrai » dans notre système de croyances…
Je parle de Minneapolis avec des amis – des gens intelligents, informés, des gens qui lisent la presse, qui suivent la politique.
Ce qui frappe n’est pas qu’on diverge sur le sens de ces morts. C’est que nous semblons avoir assisté à des événements entièrement différents.
Un ami m’envoie un fil expliquant que Pretti était un agitateur armé. Un autre m’envoie un fil expliquant que Pretti était un infirmier pacifique exécuté par des agents fédéraux.
Même homme. Même jour. Même ville. Deux planètes.
Personne n’a « planifié » ça. Ou plutôt : beaucoup ont conçu des morceaux du dispositif, pour leurs raisons à eux.
- Les plateformes ont bâti des systèmes destinés à maximiser l’engagement – et l’indignation engage.
- Les opérateurs politiques ont appris à exploiter la fragmentation.
- Les médias ont découvert que conforter les réflexes de leur audience rapporte davantage que les contrarier.

Et nous tous : nous cliquons sur ce qui « tombe juste », nous partageons ce qui confirme, nous masquons ce qui dérange...
Le résultat est le même que si quelqu’un l’avait organisé. Sauf que personne n’a besoin de le faire. La chambre d’écho ne limite pas ce que vous savez :
- Elle corrompt votre capacité à évaluer ce que vous savez.
- Elle transforme l’épistémologie en appartenance. La vérité en tribu.
Et voici l’inversion la plus profonde :
Les vidéos qui circulent depuis Minneapolis ne sont plus des fenêtres sur une réalité antérieure qu’on essaierait d’apercevoir. Elles sont la réalité – montées, découpées, sous-titrées, re-sous-titrées.
La question « que s’est-il vraiment passé ? » suppose qu’il existe quelque chose de solide en dessous. Pour des millions d’Américains, il n’y a plus « en dessous ».

L’image est l’événement. Le récit devient le fait. La carte a remplacé le territoire. Et nous oublions qu’il y eut un territoire...
Imaginez maintenant ce qui vient.
Tout ce que je décris – images contestées, réalités fracturées, récits plus rapides que l’enquête – s’est produit à partir de vidéos réelles. Granuleuses, imparfaites, mais réelles. Quelqu’un était là. Quelqu’un a tenu un téléphone.

Que se passera-t-il quand les images elles-mêmes seront fabriquées ?…
Des systèmes d’IA peuvent déjà générer des vidéos synthétiques de plus en plus photoréalistes d’événements qui n’ont jamais eu lieu :
- un responsable politique prononçant des mots qu’il n’a jamais dits,
- une manifestation « devenant » violente quand elle ne l’a pas été,
- une fusillade montrant exactement ce dont un récit a besoin.
Et la technologie n’a même pas besoin d’être parfaite. Il suffit qu’elle soit assez bonne pour produire du doute.
Pensez à ce que cela signifie pour le prochain Minneapolis.
La défense ne sera plus « cette vidéo est sortie de son contexte ». Ce sera « cette vidéo est générée par IA ». Et comment prouverez-vous le contraire ?
Chaque vidéo deviendra suspecte. Chaque preuve deviendra contestable – non parce qu’elle aura été examinée, mais parce que la catégorie même de la preuve aura été empoisonnée.
C’est vers cela que nous allons. Non par un grand plan secret, mais par la convergence de technologies, d’incitations et de faiblesses humaines qui pointent toutes dans la même direction : un monde où la réalité partagée n’est plus disponible.
« Qu’est-ce que la vérité ? » était une question de séminaire. Bientôt, nous ne partagerons même plus la même idée de ce que cette question veut dire.
Ce qui m’inquiète dans les réponses officielles à ces fusillades – et je dirais la même chose quel que soit le parti au pouvoir – c’est la vitesse.
Quelques heures après chaque mort, avant que les preuves soient sécurisées, avant que les témoins soient entendus, avant qu’une revue indépendante soit possible, le récit était fixé. Terrorisme domestique. L’histoire écrite avant qu’on puisse connaître l’histoire.
Peut-être que le récit est vrai. Peut-être que Pretti représentait une menace. J’en doute. Mais ce n’est pas mon point.

Mon point est que personne ne peut savoir si vite – et qu’une démocratie qui confond vitesse et certitude s’invite elle-même au désastre...
Ce n’est pas un problème « de gauche » ou « de droite ». C’est un problème pour quiconque pense que les citoyens devraient pouvoir savoir ce que fait leur gouvernement – et le contester quand il le faut. Pour quiconque pense que les citoyens, pas les récits, devraient être souverains.
Et la posture qui vous tente peut-être – l’épaule levée, le « qui sait, tout le monde manipule » – ce n’est pas de la sagesse. C’est une sortie de route.
C’est ainsi que le débat démocratique s’effondre et que l’escalade tribale prend la place de l’argument.
Alors, que faire ?
Arendt croyait à ce qu’elle appelait la vie obstinée des faits.
Ils remontent. Ils persistent. Ils refusent d’être ensevelis. La vérité ne gagne pas toujours vite. Mais elle a un poids que la fiction n’a pas.
C’est ce que j’essaie de me répéter :

Croire en la vérité – non comme une foi, comme une pratique...
Je ne sais pas si c’est encore possible dans notre monde, mais il faut essayer.
- Lire.
- Enquêter.
- Chercher les sources primaires.
- Soutenir les journalistes qui font un vrai travail de terrain, même quand leurs conclusions vous déplaisent.
- Être lent à partager, rapide à douter – mais douter pour comprendre, pas pour se retirer.
- Et puis faire la chose la plus difficile : sortir du fil.
Parce que le fil n’est pas une fenêtre neutre :
C’est un moteur optimisé pour la vitesse, l’émotion, la compulsion.
Il n’est pas conçu pour vous aider à savoir.
Il est conçu pour vous faire rester.
Ce n’est pas forcément « le mal ». C’est la puissance :
Et la puissance, laissée sans surveillance, ne tend pas vers la vérité.
Elle tend vers ce qui produit le prochain clic.
Il existe des issues, mais elles ne sont pas glamour.
– La première est procédurale. Les preuves doivent être préservées. Le contrôle doit être réel. Les enquêtes doivent être indépendantes. Si le public ne peut pas avoir confiance dans le fait que les faits survivront au contact des institutions, l’argument ne commencera même pas. Une démocratie repose sur l’architecture ennuyeuse de la vérification.
– La deuxième est culturelle. Il faut retrouver une vertu perdue : la honte intellectuelle – la capacité de dire publiquement, sans chercher à sauver la face : je ne sais pas encore.
- Refuser de transformer l’incertitude en arme ou en marque.
- Accepter d’attendre les faits avant d’adopter un récit comme identité.
– La troisième est personnelle : la discipline quotidienne de refuser de sous-traiter son esprit.

Ni au gouvernement. Ni aux médias. Ni à l’algorithme. Ni à son camp...
Parce que la tentation majeure, dans une crise épistémique, ce n’est pas le mensonge. C’est le soulagement – le soulagement de choisir vite une histoire, de rejoindre le chœur, de laisser la tribu penser à votre place.
Le soulagement, c’est ce qui transforme la politique en foi.
Minneapolis n’est pas le seul endroit où cela se joue. C’est un cas d’école concentré :
Deux morts, deux vidéos, deux récits officiels, deux réalités en ligne – et un pays dont la capacité à arbitrer entre elles s’érode à vue d’œil.
Peut-être que les faits remonteront. Peut-être que les enquêtes établiront ce qui s’est passé. Peut-être que les vidéos, analysées avec méthode, dissiperont ce que les cris et les légendes ont brouillé. Je l’espère. Et je ne suis pas naïve sur la fréquence avec laquelle cet espoir est déçu.
Mais le vrai combat ne porte pas seulement sur ce qui s’est passé à Minneapolis.
Il porte sur une question plus nue, plus vertigineuse : allons-nous continuer à croire qu’il existe quelque chose comme « ce qui s’est passé » ?

Voilà le désert du réel : non pas un monde où tout le monde croit le même mensonge, mais un monde où l’on cesse de croire qu’on peut distinguer la vérité du storytelling...
On peut vivre dans ce désert. Beaucoup y vivent déjà.
Ou l’on peut s’obstiner – patiemment, obstinément, presque de façon démodée – à dire que la réalité existe, qu’elle est connaissable, qu’elle mérite l’effort.
Non parce que la vérité est garantie de gagner, mais parce que sans cette tentative, la liberté n’a même plus de langage. SR♦

Simone Rodan, Substak
En savoir plus sur MABATIM.INFO
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
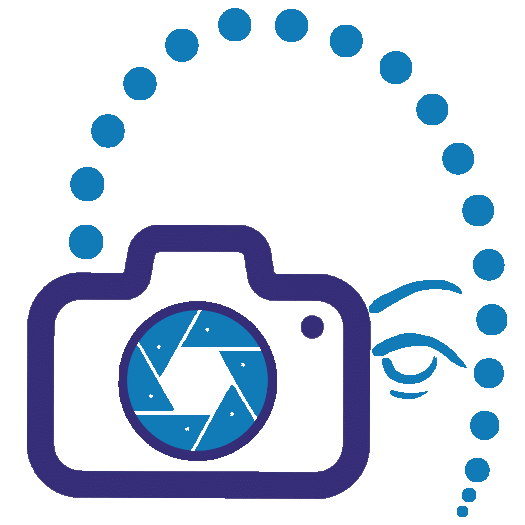

Bravo pour votre analyse de la complexité des procédés psychotisants qui mettent en échec toute symbolisation.
J’aimeJ’aime