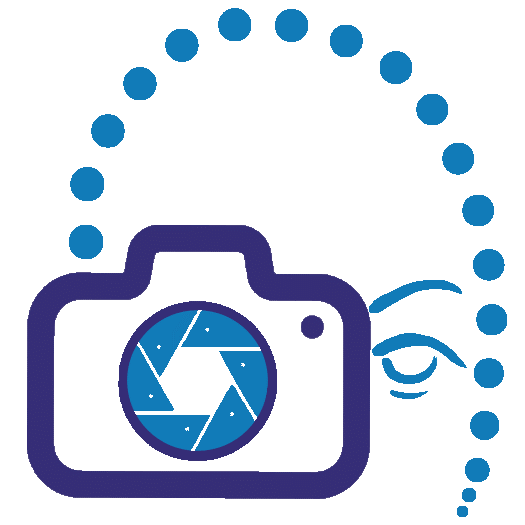Buc (Yvelines), Mars 2015
Intervention de Philippe Goldmann*
Je suis très heureux d’être parmi vous ce soir. On parle beaucoup du vivre ensemble, c’est à dire du vivre avec. La présence d’un frère franciscain me rappelle que pendant de nombreuses années j’ai été invité par la communauté franciscaine de Pau à la découverte commune de bien vieux livres qui, malgré et peut-être grâce à leur âge, étaient porteurs d’une sagesse encore vivante : le talmud. Je suis aussi heureux d’être assis à la même table que mon partenaire M. Kerroubi comme nous l’avons été ici-même depuis déjà longtemps.
Le vivre ensemble est devenu, en particulier depuis les attentats du 7 janvier et l’immense manifestation du 11, l’impératif de notre identité commune.
La fraternité, thème récurrent de la Bible
Dans un premier temps je parlerai de la fraternité. La déclaration des droits de l’homme de 1789 parlait seulement dans son article 1 de la liberté et de l’égalité : les hommes naissent libres et égaux en droit. La fraternité n’apparut que lors de la révolution de 1848, et la devise complète : liberté, égalité, fraternité fut définie par la constitution de 1848 comme un principe de la République.

Par contre, l’enjeu de la fraternité est un thème récurrent de la Bible. Immédiatement après le récit de la création, deux frères apparaissent, Caïn et Abel, mais ils ne peuvent vivre ensemble. Dans le texte, seul Abel est nommé frère, Caïn, né le premier se suffit à lui-même. Il ne tolère l’autre, né en plus (vetossef lalédet) que si son excellence propre est reconnue. Dès que cela n’est pas le cas, il supprime Abel et le mot frère disparaît du texte biblique (Manitou). Deux frères ne peuvent vivre ensemble, l’un, Abel, est l’être en plus, il est en trop. Plus tard, la recherche de fraternité aboutira à des échecs successifs. L’oncle et le neveu, Abraham et Loth se sépareront. Ensuite les deux demi-frères Ismaël et Isaac ne vivront pas ensemble. Ismaël, sur les conseils de Sarah, la mère d’Isaac, fut écarté de son frère.
Puis vient une nouvelle aventure de la fraternité avec les deux frères jumeaux Jacob et Ésaü. Après vingt-deux ans d’exil de Jacob chez leur oncle Laban, Esaü vient à sa rencontre avec quatre cents hommes, sans doute armés, et dans l’intention manifeste de se venger et de le tuer. Finalement chacun poursuit son chemin : Ésaü reprend le chemin de Séir, Jacob se dirige vers Souccot pour arriver sauf à Sichem (Naplouse) dans le pays de Canaan. Vous connaissez l’épisode de la vente de Joseph par ses frères, mus par la jalousie de le voir préféré par leur père. Finalement, malgré cette vente, Joseph devenu vice-roi d’Égypte, se dévoilera à ses frères. Je cite «Il les embrassa tous et les baigna de ses larmes ; alors seulement ses frères lui parlèrent.»
Après tous ces échecs, la fraternité trouve enfin une issue positive chez les enfants de Jacob qui surmontèrent leur haine envers Joseph et lui parlèrent. La fraternité montre sa richesse par la parole : les frères parlent à Joseph. Le dialogue, la conversation entre les hommes est la marque de la fraternité. Enfin dernier cas, les sentiments fraternels entre Moïse et Aaron sont le prototype réussi de la fraternité. Moïse revient de chez son beau-père Jéthro et Aaron qui le croyait mort après sa fuite au désert l’embrasse. Les deux frères Moïse et Aaron, l’un le guide, le chef politique inspiré par la prophétie et l’autre Aaron le prêtre.
 Avant Montesquieu, la séparation des pouvoirs…
Avant Montesquieu, la séparation des pouvoirs…
Mon maître, le rabbin Askénazi, nous a enseigné que le tabernacle construit par les Hébreux dans le désert montre la réunion des diverses fonctions qui soubassent la société. Le michkan, terme hébreu pour dire tabernacle, est l’acronyme de quatre mots: M méleh, roi, la fonction politique, CH, chofet, la fonction judiciaire, KAF, Cohen, le prêtre ,la dimension religieuse et N, navi, le prophète. Les Hébreux devaient réussir à édifier le tabernacle, afin de réunir les quatre fonctions, mais chacune à sa place, et aucune ne doit avoir la prééminence. Le politique et la religion ne sauraient être confondus : le roi ne peut exercer la prêtrise.
Mon ami, mon frère ? Mon ami ? Dans un enseignement rabbinique du haut Moyen-âge on pose la question : « qui est vaillant, qui est puissant ? » et les Rabbins répondent : « celui qui est capable de changer son ennemi en ami, en proche. »
Mon ami, mais mon ami de qui ? M. Kerroubi me permettra de citer un verset du Coran (4/125) dans lequel Abraham, Ibrahim, est qualifié d’ami de Dieu (hallil). Mais ce soir nous recherchons plutôt l’ami de l’homme, les différences justifiées ne doivent pas être des fossés infranchissables. L’autre que moi, dans sa singularité, est mon prochain. Le cardinal Lustiger a dit une fois : « qui est le prochain ? » Et a répondu : « c’est celui dont on s’approche ».
L’étranger omniprésent
S’agissant de l’autre, du différent, la Bible, l’Ancien Testament revient à de multiples reprises sur l’étranger. Vous connaissez tous ce verset du Lévitique : «tu aimeras ton prochain Kamoha », non pas comme toi-même, mais plus exactement : « tu aimeras ton prochain, l’autre, l’étranger, il est comme toi ». D’ailleurs que signifierait tu aimeras comme toi-même ? D’où savons-nous que nous devons nous aimer ? Le professeur Draï a lu le verset de façon très profonde : « tu aimeras ton prochain Kamoha, il est comme tien, tu en as la responsabilité ». Je suis responsable du maintien de la dignité de l’autre que moi, respecter sa différence et en aucun cas le réduire au même, nier sa différence, n’aimer que ceux qui sont comme moi, de la même origine, de la même religion, de la même couche sociale.
La Bible est parsemée de l’amour de l’étranger, celui qui doit devenir mon prochain, mon ami. Je ne citerai que quelques versets. Dans l’Exode 22/20 on lit «Tu n’offenseras pas l’étranger, ni ne l’opprimeras car vous avez été étrangers en Egypte.»Pour comprendre ce verset : de quelle offense, de quelle oppression s’agit-il ou encore qui est cet étranger dont nous parle le verset ? Je m’aiderai du commentaire de Rachi, le grand commentateur de la Bible et du talmud. Rachi était un rabbin français, qui vivait au 11ème siècle à Troyes. Ses commentaires ont influencé la scholastique chrétienne, en particulier Nicolas de Lyre Il explique: « tu n’offenseras pas », il s’agit d’une offense en paroles (encore une fois l’importance de la parole, du dialogue) et Rachi utilise un mot français pour mieux se faire comprendre: « offenser c’est contrarier, et tu ne l’opprimeras pas en lui volant ses biens, car vous avez été étrangers » : en effet, si tu l’offenses, lui aussi peut t’offenser et te dire : « toi aussi tu es un descendant d’étranger ». Rachi précise que le mot guer, étranger, désigne toujours un homme qui n’est pas né dans le pays, mais qui est venu d’un autre pays pour y demeurer. Quelle résonance ont notre verset et le commentaire de Rachi dans notre actualité !

On ne touche pas à l’étranger, et en plus on doit l’aimer !
Mais la Torah n’interdit pas seulement l’offense ou l’oppression de l’étranger, elle nous intime l’ordre de l’aimer. Parmi d’autres versets, on trouve le commandement d’amour de l’étranger en proximité de celui de l’amour du prochain, comme si l’un n’allait pas sans l’autre. Je cite (Lévitique 19/33): « l’étranger qui séjourne avec vous, sera pour vous comme un de vos compatriotes , tu l’aimeras comme toi-même car vous avez été étrangers dans le pays d’Égypte. Je suis l’Eternel votre Dieu» J’ajoute : « je ne serai pas votre Dieu si vous refusez de l’aimer ». Vous trouverez également cette injonction d’amour de l’étranger dans Deutéronome 11/17,18 où c’est l’Eternel lui-même qui assure de son amour pour l’étranger en le mettant en parallèle avec la veuve et l’orphelin. Le point commun entre eux est qu’ils n’ont pas ou ont perdu leur défenseur naturel, le mari ou le père.
Les prophètes d’Israël rappellent également à maintes reprises l’amour de l’étranger. Je me bornerai à une citation de Jérémie (22/3) «Pratiquez la justice et l’équité… ne faîtes subir ni avanie, ni violence à l’étranger, à la veuve et à l’orphelin… Si vraiment vous agissez ainsi alors les promesses messianiques se réaliseront.»
Vivre ensemble en action
Je voudrais terminer par une note d’optimisme et montrer comment les trois religions monothéistes se sont pacifiées et peuvent l’être encore plus. En 1948, l’historien J. Isaac, le célèbre auteur des manuels Mallet Isaac, écrivit « Jésus et Israël », œuvre dédiée à sa femme et à sa fille martyres, tuées par les Allemands simplement parce qu’elles s’appelaient Isaac. Dans son livre il met en valeur un fait que le monde chrétien semblait avoir oublié, que Jésus de Nazareth était né Juif, avait été circoncis et se conduisit toute sa vie en Juif. A la suite de l’édition de son livre avec le poète E. Fleg il contribua à la création des A.J.C. Ces dernières années sous l’impulsion du rabbin Serfaty et de l’imam Mohammed Azizi fut créée l’amitié judéo-musulmane de France, très connue grâce à son bus de l’amitié qui se rend partout y compris dans les quartiers chauds. A la suite de Vatican II en 1967 à l’initiative d’ A. Chouraqui, du R.P. Riquet et de Si Hamza Boubakeur, recteur de la mosquée de Paris, fut créée la fraternité d’Abraham. On retrouve là notre thème : mon ami, mon frère. Cette fraternité entre les trois religions à laquelle participa activement mon maître le Rabbin Askenazi. C’est la meilleure illustration du fameux vivre ensemble que j’ai évoqué au début de mon intervention. PG♦
* Philippe Goldmann a été l’élève du rabbin Léon Askenazi, mieux connu sous son totem scout de « Manitou », et également élève de Rav Rottenberg, z’l, grand rabbin de la communauté orthodoxe de Paris. Enseignant de pensée juive traditionnelle à la communauté de Versailles.