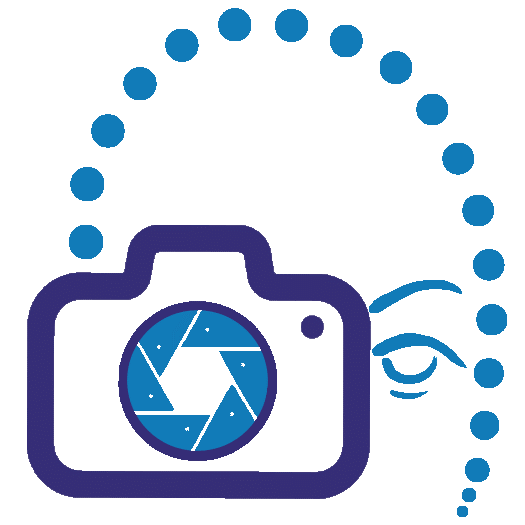Par Mireille Hadas-Lebel*
Par Mireille Hadas-Lebel*
Saint Germain en Laye, 10 mai 2018.
En 1925, Edmond Fleg fait dire au Pape Clément VII à la fin de l’acte III de sa pièce Le Juif du Pape :
Peut-être un jour pour relever le monde
Rome et Jérusalem se donneront la main
Peut-être un jour avant la fin du monde
Dieu ne fera qu’un homme avec tous les humains
Il est trop tôt ! Trop tôt pour qu’il nous soit possible.
De marcher vers ce jour par le même sentier.
Et son interlocuteur juif, Molco, répond :
« Quel que soit le chemin, la lumière est au bout
Marchons donc vers ce jour que l’ombre balbutie ;
Jour futur dont le présent se souvient
Chaque heure de la nuit en fait la prophétie
Car la nuit la plus noire est une aube qui vient.»
Edmond Fleg est mort en 1963, juste avant la publication de la Déclaration Nostra Aetate.
Coup de tonnerre en 1965 : la déclaration Nostra Aetate
Il a à peine vu poindre l’aube après la nuit la plus noire. Déjà l’abbé Toulat appelait les juifs « ses frères », déjà Fêtes et Saisons ou la petite collection Vérité ou les Cahiers de Neuilly du côté catholique, les cahiers d’études juives de Foi et Vie dirigés par Fadiey Lovsky et le Pasteur Westphal ou la revue étudiante Le Semeur du côté protestant, s’employaient à présenter le judaïsme avec amitié et respect. Encore fallait-il, du moins dans l’Église catholique si hiérarchisée, que l’impulsion vînt d’en haut. Et ce fut le coup de tonnerre de la déclaration Nostra Aetate en 1965 : le peuple juif n’était plus maudit ou rejeté, Jésus et ses disciples étaient juifs, il existait un lien spirituel entre les juifs et le peuple du Nouveau Testament. Autant d’affirmations simples et évidentes qui pourtant, pendant des siècles, avaient rencontré de vives réticences du côté chrétien. Dès 1971, l’historien protestant Fadiey Lovsky allait jusqu’à écrire que la persistance d’Israël est pour l’Église « une question intérieure qui appartient à son être propre » (La déchirure de l’absence p. 44). Depuis, des voix officielles dans l’Église catholique ont aussi proclamé que les relations entre juifs et chrétiens différaient des autres relations inter religieuses car c’était « une affaire de famille. ». Ainsi le Père Congar (Entretiens d’automne p. 52) : « Nous portons le judaïsme dans le cœur. L’islam est extérieur au christianisme, tandis que le judaïsme lui est intérieur, du moins par ses racines. »
Dans la génération d’Edmond Fleg, qui avait connu l’affaire Dreyfus, un antisémitisme catholique virulent, deux guerres, la traque et les massacres, de tels messages auraient été reçus avec des larmes de joie chez ses compatriotes israélites. Lassé d’attendre ce miracle des retrouvailles, Fleg en 1925 ne l’avait envisagé que dans un avenir lointain, un futur messianique : « Peut-être un jour, avant la fin du monde »

« Un jour avant la fin du monde »
Or il y eut la déclaration Nostra Aetate suivie de directives pour son application.
Or, un jour de 1986, il y eut la visite d’un pape dans un lieu, pourtant proche, où aucun de ses prédécesseurs n’aurait eu l’idée d’aller-la synagogue de Rome-, accompagnée de l’affirmation que les juifs étaient « frères aînés » des chrétiens.
Un jour de décembre 1993, le Saint-Siège reconnut le seul État juif au monde et établit avec lui des relations diplomatiques.
Un jour de l’an 2000, on vit à Jérusalem, dans l’État d’Israël revenu à la vie, une silhouette blanche, priant seule au pied de la muraille où, pendant des siècles, les juifs avaient pleuré leur patrie perdue.
En France, un jour de 1973 déjà, des évêques avaient publié des Orientations pastorales reconnaissant la fidélité du peuple juif et son rapport à la terre d’Israël. Vingt quatre ans plus tard, d’autres évêques rédigèrent une courageuse déclaration de repentance pour les tragédies survenues dans leur diocèse au temps de la terreur, suscitant une profonde émotion chez les juifs.
« Un jour avant la fin du monde », un cardinal français, né juif, emmena ses prêtres à New York voir comment leurs frères des yeshivot se livraient à l’étude.
« Un jour avant la fin du monde », les protestants publièrent la déclaration de Leuenberg et, cette année même, alors qu’ils célébraient Luther, dénoncèrent ses écrits antijuifs.
Si elle se compare avec les générations qui l’ont précédée, la génération qui a vu ces prodiges peut se dire heureuse. Sachons les apprécier pleinement, sans les considérer avec ce que Péguy appelle une « âme habituée ».
Dans un dialogue, il faut être deux. Les débuts de l’Amitié judéo-chrétienne, certes encouragée par des personnalités juives, ne furent pas toujours faciles. Au lendemain de la guerre et en pleine affaire Finaly, il fallait pour les juifs surmonter le soupçon selon lequel la proclamation d’amitié nouvelle était un chemin vers leur conversion. L’Assemblée du conseil œcuménique des églises qui se tenait la même année que la fondation de l’AJC (1948), n’affirmait-elle pas que « le peuple juif doit être inclus dans l’action d’évangélisation » et qu’un accueil bienveillant à son égard est partie du « devoir missionnaire » (Foi et Vie, sept – oct. 1948).
Soixante-dix ans après, que de changements !…
Les malentendus sur la conversion dissipés. L’engagement chrétien dans la lutte contre l’antisémitisme toujours confirmé. Deux projets catholiques qui heurtaient profondément la sensibilité juive (Carmel d’Auschwitz et béatification d’Isabelle la Catholique) abandonnés.
 C’est ainsi que le dialogue a pu commencer et trouver du répondant du côté juif. Ne s’est-on pas même aperçu qu’un homme de foi chrétien, aussi érudit que le Père Dupuy, avait beaucoup à nous apprendre sur le judaïsme. De leur côté, les juifs ont commencé à être plus présents dans des cercles d’études comme Davar. Alors que le chrétien redécouvrait son enracinement juif, il se produisait une évolution profonde dans le regard juif sur le chrétien. Petit à petit, des rabbins commençaient à parler des Évangiles et l’un d’eux était même invité à donner une conférence à Notre-Dame. Depuis une dizaine d’années en France, les livres « à deux voix », l’une juive l’autre chrétienne, se multiplient. Ils n’impliquent pas seulement des juifs libéraux mais même des grands rabbins de France en contact avec des évêques. Le dernier colloque de la Fédération protestante a accueilli un nombre proportionnellement non négligeable de juifs engagés dans le dialogue. Des documents officiels aux États-Unis (Daberu emet) et en Europe, la déclaration récente de quarante cinq rabbins orthodoxes, celle des rabbins européens, la déclaration française sur le jubilé de fraternité à venir, sont déjà venus concrétiser et montrer que la dissymétrie est enfin dépassée, une évolution naguère impensable. Et nous tous qui souvent étudions nos textes ensemble ne traçons-nous pas un nouveau chemin ?
C’est ainsi que le dialogue a pu commencer et trouver du répondant du côté juif. Ne s’est-on pas même aperçu qu’un homme de foi chrétien, aussi érudit que le Père Dupuy, avait beaucoup à nous apprendre sur le judaïsme. De leur côté, les juifs ont commencé à être plus présents dans des cercles d’études comme Davar. Alors que le chrétien redécouvrait son enracinement juif, il se produisait une évolution profonde dans le regard juif sur le chrétien. Petit à petit, des rabbins commençaient à parler des Évangiles et l’un d’eux était même invité à donner une conférence à Notre-Dame. Depuis une dizaine d’années en France, les livres « à deux voix », l’une juive l’autre chrétienne, se multiplient. Ils n’impliquent pas seulement des juifs libéraux mais même des grands rabbins de France en contact avec des évêques. Le dernier colloque de la Fédération protestante a accueilli un nombre proportionnellement non négligeable de juifs engagés dans le dialogue. Des documents officiels aux États-Unis (Daberu emet) et en Europe, la déclaration récente de quarante cinq rabbins orthodoxes, celle des rabbins européens, la déclaration française sur le jubilé de fraternité à venir, sont déjà venus concrétiser et montrer que la dissymétrie est enfin dépassée, une évolution naguère impensable. Et nous tous qui souvent étudions nos textes ensemble ne traçons-nous pas un nouveau chemin ?
…Mais pas d’optimisme excessif
Cependant, ne nous laissons pas aller à un optimisme excessif. À titre personnel, je sais évaluer le chemin parcouru. À l’occasion de la réflexion qui m’a été confiée aujourd’hui, il m’est revenu que le premier texte que j’aie jamais publié, (j’avais alors une vingtaine d’années et venais de découvrir l’AJCF), portait précisément sur les relations judéo-chrétiennes : six petites pages dans l’almanach annuel du KKL de Strasbourg de 1965. Après avoir évoqué les avancées de l’époque, je concluais ainsi :
« Un point positif est désormais acquis, cette curiosité sympathique, cette volonté de compréhension dont témoignent la plupart des revues chrétiennes citées, la lutte contre les préjugés, préliminaire à tous les rapprochements, est en bonne voie. Mais ni chrétiens ni juifs ne se font illusion sur l’efficacité d’une telle campagne à brève échéance. Certes, le nouveau catéchisme s’efforce d’appliquer les dix points de Seelisberg, mais il faut compter avec les idées reçues dans le contexte familial, l’immobilisme d’une partie du clergé désorienté par les nouvelles directives et ne sortant pas d’un enseignement routinier. L’expérience quotidienne montre que trop de préjugés habitent encore les cœurs. Quand le mouvement d’ouverture annoncé par l’élite des chrétiens s’étendra-t-il aux masses ? « Peut-être un jour … »
Si j’ose me citer ainsi, c’est que des décennies plus tard, je retrouve les mêmes interrogations dans le petit livre du Père Dujardin, Catholiques et juifs 50 ans après Vatican II, où en sommes-nous ? : Chapitre VIII : « Où en est le dialogue dans la communauté catholique de base ? »
Quels défis nous attendent ?
Si nous ne pouvons répondre à une question aussi vaste qui nécessite une enquête approfondie, tâchons au moins de répondre à la question de ce jour : quels défis nous attendent ?
J’ai le privilège d’être fréquemment invitée à parler devant nos groupes de Paris ou de province. Partout, je rencontre non seulement des personnes extrêmement dévouées, des salles remplies et chaleureuses, mais des chrétiens possédant une connaissance profonde et bienveillante du judaïsme. Je ne saurais dire combien je suis reconnaissante aux animateurs de ces groupes pour leur action.
En confrontant avec eux mes observations, je retiens quatre défis :
- Y a-t-il une relève dans la nouvelle génération ?
- La diffusion de Nostra Aetate auprès du public catholique et des déclarations de Leuenberg auprès des protestants reste imparfaite
- La participation des juifs au dialogue judéo chrétien est insuffisante
- Le rapport à Israël dans le dialogue judéo-chrétien
 Y a-t-il une relève dans la nouvelle génération ? Les jeunes sont en effet peu visibles dans nos assemblées
Y a-t-il une relève dans la nouvelle génération ? Les jeunes sont en effet peu visibles dans nos assemblées
La relève existe potentiellement parmi les jeunes qui participent à de vastes rassemblements interreligieux comme ceux de la Meilleray ou de Paray le Monial ou encore parmi les lycéens qui font le voyage à Auschwitz sous la direction d’un guide spirituel comme l’était le P. Dujardin. Cette jeunesse s’engage-t-elle dans l’AJCF ? On peut observer que partout l’individualisme s’accroît. Beaucoup de ces jeunes seront vite repris par leurs études, seront attirés par d’autres engagements et, dans le meilleur des cas, trouveront l’amitié judéo-chrétienne si évidente qu’il leur suffira de l’exercer sur le plan personnel. Dans certaines sociétés savantes dont je suis membre, il n’y a pas davantage de jeunes. Ils ne se déplacent plus pour écouter des conférences à l’heure où tant d’informations leur sont apportées par leur ordinateur. Les formules anciennes doivent donc être repensées. Il faudrait réfléchir à de nouvelles techniques qui permettent de faire passer le message de l’Amitié judéo-chrétienne aux nouvelles générations et mieux utiliser l’outil Internet devenu indispensable, ce qu’a commencé à faire notre site qui mérite d’être mieux connu.
La Croix du 21 mars 2018 titrait : « Les jeunes Européens de plus en plus loin des religions » et notait un recul de la pratique chrétienne mais relevait aussi que si les jeunes chrétiens, étaient certes moins nombreux, ils étaient plus impliqués. On peut en dire autant des jeunes juifs. C’est sur cette jeunesse que repose notre espoir.
 La diffusion de Nostra Aetate auprès du public catholique et des déclarations de Leuenberg auprès des protestants reste imparfaite
La diffusion de Nostra Aetate auprès du public catholique et des déclarations de Leuenberg auprès des protestants reste imparfaite
Dans son petit livre, Catholiques et juifs. 50 ans après Vatican II (2012) le P. Dujardin s’interrogeait sur « le degré de pénétration du travail accompli dans le monde chrétien ». Un questionnaire envoyé à quatre vingt quinze évêques, portant sur l’enseignement de Nostra Aetate et des textes qui ont suivi, lui ont valu un nombre infime de réponses.
S’il ne fait pas de doute que les délégués diocésains œuvrent à l’Amitié judéo-chrétienne avec un dévouement et une persistance admirables, ils n’ont pas toujours le soutien effectif de leur hiérarchie. Le prêtre en chaire est souvent prisonnier de la rhétorique ancienne qu’il a lui-même entendue et la doctrine de la substitution refait souvent surface. Des prêtres formés à l’étranger, en Pologne ou en Afrique, n’ont jamais été mis au contact de ces textes et se positionnent, sans en être conscients, dans l’avant Vatican II. Comment le public pourrait-il suivre dans ces conditions ? Encore le public chrétien qui fréquente les églises aurait-il une chance de le faire dans le meilleur des cas. Mais ce public est, nous dit-on, en forte régression. Ce qu’il reste de christianisme aux chrétiens qui ne sollicitent leur église que dans les grandes occasions est l’écho de tous les préjugés d’autrefois : la chair contre l’esprit, les trente deniers de Judas qui montrent la prédisposition des juifs à la trahison pour de l’argent, le légalisme contre l’amour, le talion contre le pardon, sans parler de la substitution du Verus Israël à l’ancien. Tout cela sévit encore très fort et ne demande qu’à renaître.
Il faut ajouter qu’un autre interlocuteur des églises est apparu sur la scène européenne : l’islam. Sa force numérique oblige à compter avec lui. Le judaïsme n’intéresse la chrétienté que par ce qu’il lui enseigne sur ses racines. Si l’intérêt des chrétiens se concentre, non pas sur les origines mais sur le présent, le nombre, voire la menace, imposent de nouvelles priorités. Comme nous le signalait un de nos membres de province, il n’y a plus de place pour le dialogue avec le judaïsme.
 3) La participation des juifs au dialogue judéo chrétien est insuffisante
3) La participation des juifs au dialogue judéo chrétien est insuffisante
C’est vrai, les juifs sont peu nombreux dans nos groupes d’amitiés mais il faut avoir à l’esprit qu’ils ne représentent que moins de 1 % à l’échelle du pays. Ce n’est toutefois pas la seule raison.
Beaucoup de juifs ne pratiquent que par tradition et sont ignorants de leur propre patrimoine. Ils ne se sentent pas suffisamment formés pour dialoguer avec des intellectuels chrétiens qui en savent plus que sur le judaïsme et son histoire. Certains de leurs « rabbins » sont parfois de simples « ministres officiants » qui n’ont pas eu accès à une formation universitaire et n’osent pas entrer en dialogue avec les évêques locaux.
Dissymétrie du dialogue
Un argument souvent invoqué pour expliquer la dissymétrie du dialogue est que le christianisme a besoin du judaïsme pour mieux se comprendre lui-même et que l’inverse n’est pas vrai. C’est sans doute là une réaction qu’il faut prendre en compte. Mais les juifs ne sauraient vivre dans un pays autant marqué par le christianisme que la France, sans s’efforcer de connaître ce qui a inspiré son art, sa littérature, ses monuments, tout ce qui constitue notre culture, notre paysage.
Les juifs ont aussi à apprendre de la spiritualité chrétienne. Si les imprécations des Pères de l’église, malgré quelques efforts récents, ne peuvent donner matière à dialogue, il reste les Évangiles et les épîtres pauliniennes où le judaïsme peut redécouvrir une partie de lui-même il y a deux mille ans. C’est-ce que nous avons commencé à faire dans le cadre de la commission théologique de l’AJCF, à une très petite échelle encore, il est vrai. De part et d’autre le danger vient de l’ignorance. Grâce au dialogue, de même que le chrétien revient souvent aux sources bibliques et découvre une pensée juive d’une richesse insoupçonnée, de même le juif lit le Nouveau Testament sans prévention avec le sentiment de retrouver les siens.
Y aura-t-il encore assez de juifs ?
Un danger autrement plus important nous guette. Dans quelques années y aura-t-il encore des juifs pour dialoguer avec leurs frères chrétiens ? « L’Europe va se vider de ses juifs. En France 60 000 sont partis en dix ans. » titrait Le Monde du vendredi 30 mars. L’insécurité que les islamistes font régner a déjà chassé les enfants juifs de nombreuses écoles publiques et les familles juives de certains quartiers. Sans parler des meurtres qu’on n’a pu empêcher, comment prévenir ou punir le harcèlement quotidien, les crachats, ce qu’on appelle pudiquement les «incivilités ». Les courants migratoires qui amèneront nécessairement de plus en plus de musulmans en France et en Europe ne feront qu’accentuer les tendances déjà existantes. Ainsi « la menace est dans toutes les têtes » et les plus menacés songent au départ. J’avais déjà rédigé ces quelques lignes lorsqu’est paru le Manifeste contre le nouvel antisémitisme que l’AJCF a diffusé. Le modèle de Vatican II y est proposé aux musulmans, mais nous savons que c’est irréalisable pour une religion qui n’a pas de magistère et pour laquelle le Coran est le sceau ultime de la Révélation.
Avenir en France compromis ?
Cette initiative apporte au moins un peu de baume au cœur de ceux qui voyaient leur avenir dans notre pays de plus en plus compromis par une violence d’une origine que les bien pensants n’osent même pas nommer. Or il faut nommer les dangers pour les affronter. Si nous en sommes là où nous sommes, c’est que pendant vingt ans au moins – mais je peux apporter des témoignages plus anciens – on a laissé faire et même vécu dans le déni. Et qu’on ne nous parle pas d’islamophobie ! Ce sont des musulmans éclairés qui nous alertent contre ces dérives de leurs coreligionnaires, mais ceux là même se font réprimander par de doctes sociologues français pour qui notre société occidentale est responsable de tout le mal.
Les juifs de diaspora paieraient-ils pour les Palestiniens ?
Alors il y a le CONFLIT me direz-vous, le sort des Palestiniens que l’on ferait payer aux juifs de la diaspora. Cet argument est dénoncé par ceux qui ont lu dans le Coran les sourates de Médine, beaucoup plus porteuses de haine que celle de la Mecque, et lorsqu’on sait que les versets les plus récents priment sur les précédents, on comprend l’usage qu’en font certains prédicateurs. Comme l’affirme Berdiaeff, « l’antisémitisme religieux est le plus sérieux, le seul qui mérite d’être étudié ».
 4) Cela m’amène à mon quatrième point : le rapport à Israël dans le dialogue judéo-chrétien
4) Cela m’amène à mon quatrième point : le rapport à Israël dans le dialogue judéo-chrétien
Pour avoir constaté, jusque dans nos groupes d’amitié, une dégradation de l’image d’Israël qui nuit aux relations établies entre juifs et chrétiens, Jacqueline, notre présidente, a courageusement mis au programme de nos réunions la question du sionisme et de l’antisionisme.
Justice pour le sionisme
Une propagande, développée d’abord en URSS dans l’après-guerre et chez ses satellites puis dans les milieux gauchistes d’après 1968, a entouré le terme « sioniste » d’un halo sulfureux qui a fini par s’introduire dans le vaste public, lequel serait bien en peine de donner une définition du sionisme. Alors soyons clairs : le sionisme, un terme forgé au début du XXe siècle sur Sion, une des collines de Jérusalem, appelle les juifs à former un État où ils seraient majoritaires afin d’échapper aux persécutions et de mener une vie libre et digne dans ce qui fut la terre de leurs ancêtres. Ce rêve s’est réalisé en 1948 avec la création de l’État d’Israël. Être « antisioniste » signifie s’opposer à l’existence même de cet état : les juifs seraient ils donc les seuls qui n’auraient pas droit à leur pleine indépendance. ? Dans l’inconscient surgit peut-être le mythe du juif condamné à une éternelle errance.
Je ne crois pas qu’il y ait des antisionistes parmi les membres de l’AJCF. Qu’il y ait des critiques d’Israël, rien de plus légitime. Qu’il suffise d’ailleurs de rappeler que nombre de critiques internes en Israël même s’expriment justement au nom de l’idéal sioniste et ce, avec une passion et une liberté de ton qui confirment la vitalité de la démocratie israélienne. Ne tombons donc pas dans le faux problème : « A-t-on le droit de critiquer Israël ? » Ce qu’il faut déterminer c’est à partir de quelle formulation la critique amie, soucieuse, devient animosité et résurgence des vieux préjugés.
Certains propos fréquemment répétés doivent nous faire dresser l’oreille :
- Les Israéliens font aux Palestiniens ce que les nazis leur ont fait.
- Le conflit israélo-arabe est « la mère de toutes les batailles », la source du chaos proche-oriental et risque de nous mener à une troisième guerre mondiale.
Israël, ce pelé, ce galeux, d’où vient tout le mal…
Sans le dire explicitement, ceux qui tiennent de tels propos dénient à Israël le droit à l’existence. Qui voudrait soutenir un régime nazi ? Qui ne voudrait se débarrasser d’un petit État dont l’existence mène le reste du monde à la catastrophe ? Israël devient ainsi l’âne de la fable «Les animaux malades de la peste » : « On cria haro sur le baudet, ce pelé, ce galeux, d’où venait tout le mal ».
Il est vrai que l’ensemble de la presse ne voit Israël que par les yeux des Palestiniens : occupation colonies, apartheid, mur de la honte, réaction disproportionnée. À regarder le journal télévisé, le pays lui-même ne comprendrait qu’une jeunesse militarisée et des fanatiques vêtus de noir qui se balancent au mur des Lamentations. Le reste d’Israël n’existe pas. À leur retour de voyage, nos amis chrétiens s’entendent dire : « Vous étiez là-bas ! » Ou pire : « Comment osez vous aller là-bas ? » Le nom d’Israël brûle les lèvres.
Certains réflexes chrétiens sont plus particulièrement sollicités en faveur des Palestiniens.
La vie quotidienne au temps de Jésus ?… Anachronisme !
Il y a d’abord l’effet du nom de Palestine. L’auteur de La vie quotidienne au temps de Jésus, un livre encore empreint de tous les stéréotypes antérieurs à Vatican II, Daniel-Rops qui ne serait certainement pas inscrit à l’AJCF, remarque dès l’abord que Jésus-Christ eût été bien surpris d’apprendre qu’il vivait en Palestine, lui qui ne connaissait que la Galilée et la Judée : « Si étonnant que le fait puisse paraître, ce terme était moins qu’usuel il y a 2000 ans. En tout cas, le peuple qui occupait ces lieux, les hommes qui y avaient pris racine, n’auraient jamais eu l’idée d’appeler Palestine leur patrie. La Bible ignore ce mot… ». Il n’en demeure pas moins que l’impact du nom reste très fort sur les consciences chrétiennes. Dans son discours de réception d’un évêque, une académicienne concluait sur « Jésus le Palestinien ». La plupart des pèlerinages en « Terre Sainte » évitent sciemment le pays juif mais pas les territoires palestiniens.
S’agit-il d’un nouvel antijudaïsme ?
À l’heure où les préjugés théologiques volent en éclat, un nouvel antijudaïsme n’est-il pas en train d’apparaître ? La compassion évangélique est bien souvent sollicitée par l’image. On a pu voir dans la presse des dessins accusateurs : une Palestine crucifiée, une mater dolorosa tenant un enfant palestinien, un massacre des Innocents renouvelé. Rien sur les autobus qui explosent à l’heure de la sortie de l’école, rien sur les enfants, dont un bébé de trois mois, égorgés dans leur lit avec leurs parents un soir de shabbat, et bien d’autres encore.
Je comprends que l’attitude évangélique porte à la compassion pour celui qui est réputé le plus faible. Mais regardons les cartes. Un minuscule État dans un environnement arabe hostile. Que serait Israël s’il n’avait pas appris à se défendre ?
Je vous parle comme à des amis. Mais il y a des lustres que mes vieux amis évitent de me parler d’Israël pour ne pas me dire tout le mal qu’ils en pensent puisqu’ils lisent les journaux et se sentent plus justement informés que moi. D’ailleurs ma réponse serait inaudible. Les juifs sont partisans, c’est bien connu. Et s’ils demandaient seulement un peu plus d’équilibre ? Le sentiment d’une hostilité généralisée envers un Israël dont ils ont une tout autre vision, n’est pas pour rien dans le départ de certains juifs de ce pays.
Voyage en Israël
Notre association prépare un voyage en Israël. Rien ne peut mieux faire comprendre ce qu’il en est réellement, dans un pays qui compte tant de réalisations, où la jeunesse pense qu’il fait bon vivre, le seul pays du Proche-Orient où la minorité chrétienne croît en nombre et n’est pas persécutée. Un tel voyage est prévu pour l’automne avec pour guide frère Louis-Marie qui, après y avoir séjourné 35 ans, connaît le pays dans tous ses aspects, mieux que s’il y était né. Je donne rendez-vous aux participants au lendemain de cette expérience.
 Aux termes de cet exposé, je constate combien notre association est miraculeuse et combien elle est fragile. Il tient à vous, à nous, à la relève, qu’elle poursuive ce grand élan de fraternité. MHL♦
Aux termes de cet exposé, je constate combien notre association est miraculeuse et combien elle est fragile. Il tient à vous, à nous, à la relève, qu’elle poursuive ce grand élan de fraternité. MHL♦
* Historienne spécialiste de l’histoire du Judaïsme, Vice-Présidente de l’AJCF
Voir aussi :