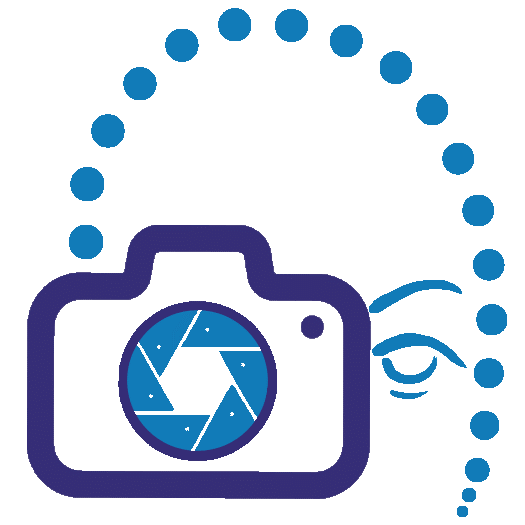En Europe et même dans le monde, le mois d’octobre peut être considéré comme le début de la saison des prix, décernés par les différentes académies et fondations. Depuis 1901 les plus prestigieux sont attribués à Stockholm et à Oslo, en mémoire d’Albert Nobel[1], inventeur de la dynamite, qui par son testament de 1895 écrit à Paris, instaura cette tradition. Il stipula alors que ces récompenses attachées à son nom seront attribuées aux scientifiques qui par leurs travaux auront apporté des bienfaits certains à l’humanité. Parallèlement, il créa le prix de littérature pour des œuvres d’une grande valeur et demanda aussi de distinguer les personnes ou les organisations connues pour leurs efforts en faveur de la paix. Ainsi, le marchand d’armes très fortuné, décida que son argent devrait récompenser ceux pour qui la paix était une valeur suprême. Depuis 1968, un sixième prix, celui de l’économie a été rajouté à la liste initiale avec l’accord de la Fondation Nobel.
En Europe et même dans le monde, le mois d’octobre peut être considéré comme le début de la saison des prix, décernés par les différentes académies et fondations. Depuis 1901 les plus prestigieux sont attribués à Stockholm et à Oslo, en mémoire d’Albert Nobel[1], inventeur de la dynamite, qui par son testament de 1895 écrit à Paris, instaura cette tradition. Il stipula alors que ces récompenses attachées à son nom seront attribuées aux scientifiques qui par leurs travaux auront apporté des bienfaits certains à l’humanité. Parallèlement, il créa le prix de littérature pour des œuvres d’une grande valeur et demanda aussi de distinguer les personnes ou les organisations connues pour leurs efforts en faveur de la paix. Ainsi, le marchand d’armes très fortuné, décida que son argent devrait récompenser ceux pour qui la paix était une valeur suprême. Depuis 1968, un sixième prix, celui de l’économie a été rajouté à la liste initiale avec l’accord de la Fondation Nobel.
À sa mort, Albert Nobel laissa 31,5 millions de couronnes suédoises de l’époque, ce qui correspond approximativement à 180 millions d’euros. En 1900, la Fondation, chargée de l’exécution de sa volonté, fut organisée avec des comités responsables pour chaque prix ; elle gère le capital laissé par le riche industriel et contrôle le long processus de la désignation des candidats. Actuellement chaque lauréat touche environ 750.000 euros et décide en toute indépendance de l’utilisation de cet argent. Les premiers récompensés furent désignés en 1901 : Wilhelm Röntgen en physique, Jacobus Henricus van‘t Hoff en chimie, Emil Adolf von Behring en médecine, Sully Prudhomme en littérature et le prix de la paix a été partagé entre Henry Dunant et Fréderic Passy. À l’époque, ce choix pouvait sembler tout à fait judicieux, le premier étant le fondateur en 1863 de la Croix-Rouge et le second un pacifiste convaincu qui ne ménageait pas sa peine pour favoriser des accords internationaux, des pourparlers lors de différents conflits, et qui avait participé à la création de la Société d’arbitrage entre les Nations, fondée en 1870 et qui présageait déjà l’ONU.
Si les lauréats sont connus en octobre, par tradition, la remise des prix a lieu le 10 décembre à Stockholm, jour anniversaire de la mort d’Albert Nobel, dans une atmosphère très solennelle, en présence de la famille royale de Suède. Cependant le prix de la paix est remis par le roi de Norvège, le même jour, mais à Oslo. Il se trouve que jusqu’en 1905 ces deux pays formaient une union personnelle avec le roi de Suède à la tête de cette structure binationale. Après la séparation intervenue au début du XXe siècle, la Norvège garda la main sur le prix de la paix, tous les autres sont restés dans l’escarcelle de la Suède.
Discussions acharnées
Tous les ans à l’approche de la proclamation des lauréats, les discussions peuvent être acharnées ; deux prix, celui de littérature et celui de la paix provoquent des supputations particulièrement vives et des pronostics la plupart du temps non confirmés par les décisions finales. D’ailleurs nous pourrions dresser une liste des grands écrivains qui n’ont pas eu ce prix et qui pourtant l’auraient mérité plus que certains lauréats : Léon Tolstoï, Anton Tchékhov, Joseph Conrad, Franz Kafka, Robert Musil, Jorge Luis Borges… Parallèlement, on pourrait citer de nombreux lauréats tombés depuis dans un doux oubli.
Au secret pendant cinquante ans
Probablement pour cette raison, dès la mise en route de cette subtile mécanique de l’attribution des prix, il était prévu que les nominations de candidats et le contenu des délibérations des jurys seraient gardés secrets pendant cinquante ans. En principe, le Comité Nobel devrait être neutre et résister à la pression politique. Mais plusieurs décisions prouvent le contraire. On peut rappeler à ce titre le scandale en 1958 lors de l’attribution du prix à Boris Pasternak pour son roman Docteur Jivago, très critique envers le régime soviétique publié en russe, non pas en Union Soviétique, mais en Italie par l’éditeur milanais Giangiacomo Feltrinelli, membre du parti communiste italien. L’édition française, chez Gallimard, suivit en été 1958. Le livre devint un best-seller en Occident et fut rapidement porté à l’écran. Mais une campagne violente de dénigrement orchestré s’était déchaînée dans son pays contre le poète, qualifié dans la presse « d’agent de l’Occident capitaliste, anticommuniste et antipatriotique ». Il fut exclu de l’Union des écrivains et de nombreuses personnes exigèrent son expulsion d’Union Soviétique. Pour pouvoir rester dans sa patrie, le poète décida de refuser le prix Nobel[2]. Brisé, il mourra en 1960, mais durant des années, jusqu’à l’arrivée de Gorbatchev au pouvoir, il était pratiquement interdit en Union Soviétique de prononcer son nom, et les lecteurs du roman, qui circulait dans le « samizdat »[3], risquaient d’avoir des ennuis avec les services soviétiques de sécurité.
Pour « se réconcilier » avec le gouvernement de l’URSS, le Comité Nobel décida en 1965 de décerner le prix à Mikhaïl Cholokhov pour son roman Le Don paisible.[4] Effectivement, Cholokhov, membre du parti communiste et enfant chéri du régime, plaisait bien plus aux officiels. Lui au moins n’était pas le fils d’artistes juifs, toujours suspects…
Déjà cent Nobels de la paix décernés
Parmi tous les prix Nobel, celui de la paix est auréolé d’un prestige tout particulier. À ce jour, il a été décerné 100 fois, car il n’a pas attribué pendant les deux grands conflits mondiaux ni les années où le jury n’est pas parvenu à un accord sur le nom du candidat. Le processus de désignation est bien long, et la première liste peut contenir plusieurs centaines de noms, proposés par des spécialistes internationaux de sciences politiques et de droit. Les anciens lauréats peuvent aussi exprimer leurs préférences ainsi que des parlementaires de différents pays et les membres du Tribunal International à la Haye. Le Comité norvégien s’adresse aussi à des conseillers spéciaux qui rédigent une liste argumentée ; après des mois de discussions serrées, au printemps de chaque année, on arrive à cinq prétendants parmi lesquels on choisira le finaliste. Si les premiers lauréats venaient surtout de l’Europe occidentale et des États-Unis, progressivement les origines seront étendues à tous les continents. C’était bien le cas en 2019, car le prix a été attribué au premier ministre éthiopien Abyi Ahmed pour ses efforts dans l’instauration de la paix entre l’Éthiopie et l’Érythrée.
Certains espéraient que le Comité reconnaitrait enfin, après plusieurs candidatures infructueuses, l’importance de la plus ancienne ONG russe, le Mémorial, fondé par l’académicien Andreï Sakharov[5] en 1989 et qui depuis 30 ans tente, malgré d’ immenses difficultés, de promouvoir en Russie une société civile fondée sur le droit, de façon à prévenir le retour du totalitarisme. Depuis sa fondation, le Mémorial travaille aussi activement à la sauvegarde de la mémoire des victimes des répressions politiques, exercées par le régime bolchévique. Dans la Russie de Vladimir Poutine, où nous voyons réapparaître des prisonniers politiques, cette organisation est régulièrement attaquée le FSB[6] et des instances judiciaires complétement corrompues à la botte du pouvoir exécutif. Il est vrai aussi que les Russes n’étaient pas nombreux à recevoir ce prix, Sakharov étant le premier, puis après lui il n’y avait que Mikhail Gorbatchev (1990).
Il arrive que certains récipiendaires, au bout d’un certain temps semblent agir en contradiction avec les exigences énoncées par Albert Nobel. L’exemple récent concerne Aung San Suu, détentrice du prix en 1991 et qui, devenue Ministre des Affaires Étrangères de Birmanie, resta étrangement passive au moment des persécutions des Rohingyas dans son pays en 2016-2017.
En consultant les listes des candidats écartés par le jury, rendues publiques au bout de 50 ans, on peut être surpris, voire scandalisé par certaines propositions, avancées par des personnes habilitées. Ainsi en 1935 le nom de Benito Mussolini avait été soumis au Comité ; quatre ans plus tard au printemps 1939, Erik Brandt, membre du Parlement suédois suggèrera la candidature d’Adolf Hitler, pour revenir au bout de quelques jours sur sa décision ! En 1945 et 1948, le nom de Joseph Staline était évoqué, mais il n’a pas été retenu pour la liste définitive.
Beaucoup de recalés
Or il est certain que parmi les « recalés », il y a des personnes qui mériteraient d’être lauréats !
Parmi les oubliés on pourrait surtout rappeler le Mahatma Gandhi, nommé pourtant à cinq reprises, en 1937, 1938, 1939, 1947 et 1948, l’année de son assassinat. D’ailleurs après sa mort, le Comité n’a pas attribué le prix, en expliquant qu’il n’avait pas trouvé de candidat vivant qui correspondant à ses exigences et qu’il souhaitait ainsi rendre l’hommage à Gandhi.
On pourrait ainsi continuer cette énumération. Par exemple, dès 1901 parmi les candidats « recalés », il y avait Jan Gotlib Bloch, né en 1836 à Radom, ville qui se trouve au sud de Varsovie[7]. Sans aucun doute, sa biographie aurait plu à Albert Nobel !
Il était né dans une famille juive assez prospère, car son père possédait une petite usine textile. Après avoir fréquenté le kheder, il a été scolarisé dans un lycée de Varsovie et a terminé sa formation par des études à l’Université de Berlin. Dans les années 1860, il se consacra à la construction du chemin de fer, une activité en plein développement dans l’Empire russe. Il portait le surnom bien évocateur de « Roi du chemin de fer ». Devenu très riche, il se fera connaître comme un grand philanthrope. À la fin du XIXe siècle, lorsque le sionisme commençait à devenir de plus en plus populaire, Jan Gotlib Bloch participait souvent aux travaux de la filiale russe de la Jewish Colonization Association, lui faisant de nombreux dons.
Il était l’auteur d’un important ouvrage en six volumes, intitulé La guerre de l’avenir, traduit en plusieurs langues, dans lequel il présentait d’une manière approfondie et détaillée les conséquences désastreuses d’une guerre moderne. Il prévoyait des conflits longs, des pertes parmi des militaires et surtout des dommages immenses pour la population civile. Ces guerres modernes devraient affecter aussi l’économie mondiale. Il évoquait même des révolutions, des affrontements civils, des épidémies et des famines ; malheureusement ce scénario s’avèrera pendant les conflits à venir du XXe siècle !
En 1899 Jan Gotlib Bloch est devenu l’un des organisateurs de la Première conférence de la Haye qui a fait avancer la cause du droit international humanitaire. À cette occasion fut créée La Cour permanente d’arbitrage de la Haye, et la conférence interdira l’usage de certaines munitions, comme les balles dum-dum[8] et les baïonnettes à dents de scie.
Il sera nominé pour le prix Nobel de la paix en 1901, sans devenir le lauréat. Comme il est mort le 7 janvier 1902 à Varsovie, son nom ne paraît plus dans les archives du Comité Nobel.
Dans la période entre 1905 et 1917, nous trouvons dans les archives du comité Nobel 14 évocations de Ludwik Zamenhof, l’inventeur de l’espéranto[9]. Des groupes de parlementaires britanniques, français, suédois, revenaient à la charge pendant toutes ces années. Zamenhof était aussi souvent cité par des universitaires qui appréciaient son travail de linguiste. Ces nombreuses propositions prouvent la popularité de l’ophtalmologue de Varsovie. Mais il est mort en 1917, à 58 ans, quand la première guerre mondiale faisait rage et l’attribution du prix était suspendue jusqu’à la fin du conflit.
Dans les annales un peu plus tardives, établies dans les années 1930, nous trouvons souvent des juristes qui voyaient avec effroi des dangers pour la paix dans le monde où les régimes totalitaires se renforçaient. Un bon exemple est donné par Hermann Kantorowicz (1877-1940), né à Poznan dans une famille juive. Il fut présenté en 1934 par plusieurs juristes et universitaires suédois.
Quelques juifs
Cette candidature permet d’évoquer des Juifs, établis depuis des siècles dans la partie de la Pologne, prise par la Prusse lors des partages de la fin du XVIIIe siècle. Cette communauté était bien moins nombreuse que celles de l’Empire Austro-Hongrois ou de l’Empire russe. Dès la première moitié du XIXe siècle, ces Juifs étaient attirés par les idées de la Haskala, proche de la philosophie des Lumières. Nous observons alors une forte germanisation de cette population qui adhère à la langue et la culture germaniques, tout en gardant leur attachement à la religion des ancêtres. D’ailleurs en 1918 lorsque la Pologne retrouve son indépendance, de très nombreux Juifs de ces régions préfèrent partir pour l’Allemagne, considérant qu’ils auraient là-bas de meilleures perspectives.
C’était exactement le parcours du professeur Kantorowicz, diplômé de l’Université de Berlin et de Genève. Il obtient son doctorat en 1900 à l’université de Heidelberg et ensuite enseigne pendant de longues années dans les universités allemandes jusqu’à l’arrivée au pouvoir des nazis. Ce juriste libéral a perdu sa chaire parmi les premiers, d’autant plus que contrairement à l’opinion très répandue dans le pays, il considérait que l’Allemagne avait une grande responsabilité dans le déclenchement de la première guerre mondiale. Après un séjour aux États-Unis, il se réfugie en Grande Bretagne où il enseigne à Oxford et Cambridge. Il meurt en février 1940.
Un autre juriste, Raphaël Lemkin a failli atteindre le record de Zamenhof, car entre 1950 et 1959, l’année de sa mort, il avait été nominé 10 fois !
Né en 1900 dans un village qui se trouve aujourd’hui en Biélorussie, mais qui était à l’époque sous l’administration russe, Raphaël Lemkin grandit dans la famille d’un métayer juif. Un principe dans l’Empire russe, les Juifs n’avaient pas le droit de cultiver la terre et son père était obligé de contourner la loi, en « graissant la patte » aux fonctionnaires qui venaient de temps en temps faire des contrôles. Néanmoins, Raphaël avait gardé de très bons souvenirs de ses premières années ; dans ses Mémoires il parle d’une enfance idyllique, passée au milieu de coqs et autres animaux, d’un gros chien répondant au nom de Riabtchik, d’un grand cheval blanc, et du « chuchotement métallique » des faux que l’on agitait pour couper le trèfle et le seigle dans les champs. La nourriture était simple mais abondante : pain noir et oignon crus, flan aux pommes de terre. Lemkin apportait son aide dans la ferme située non loin d’un vaste étang bordé de bouleaux blancs sur lequel ses frères et lui naviguaient dans des barques qu’ils fabriquaient eux-mêmes, jouant aux pirates et aux Vikings.[10]
Or dans la famille du métayer juif on ne badinait pas avec l’éducation des enfants, d’autant plus que Bella, sa mère, était une lectrice passionnée qui connaissait plusieurs langues. Raphaël commença à étudier la Bible à l’âge de six ans, puis les parents déménagèrent dans une ville plus grande pour donner une meilleure éducation aux enfants ; plus tard Lemkin fréquentera le lycée de Bialystok, la capitale de la région.
Mais les bruits menaçants arrivaient même dans cette campagne reculée. Les enfants entendaient parler de pogroms et de violences contre les Juifs ; en 1911 les parents commentaient longuement le procès de Beïlis qui se tenait à Kiev[11].
Dans les années 1920 Lemkin étudie à la faculté de droit de Lvov/Lemberg où il obtint son diplôme en 1926. Pendant ces études, il discutait souvent avec ses professeurs du massacre des Arméniens, organisé par des Turcs en 1915. Il considérait déjà qu’il faudrait établir dans le droit international une procédure spéciale pour de tels crimes. Ensuite, dans les années 1930 il participera au Conseil juridique de la Société des Nations et en 1933 il préparera un texte sur la prévention de la barbarie et du vandalisme, ce premier concept évoluera avec le temps vers celui de génocide.
Mobilisé en 1939, il parvint à quitter la Pologne occupée et arriva à se réfugier en Suède, tout d’abord, et aux États-Unis en 1941. Presque toute sa famille, restée en Pologne, sera anéantie durant la guerre.
En 1944 dans son livre principal Axis Rule in Occupied Europe il utilise pour la première fois le terme de « génocide », repris plus tard par Robert H. Jackson, chef de la délégation américaine pendant le procès de Nuremberg et dont Lemkin était conseiller.
En décembre 1946, l’Assemblée générale de l’ONU adopte la résolution stipulant que le « génocide nie le droit à l’existence de groupes humains entiers » et qu’il s’agit « un crime au regard du droit international ». À l’époque, cette assemblée avait lieu à Paris ; pour commémorer cet événement et le rôle de Raphaël Lemkin, le 10 décembre 2008 une plaque a été apposée au Palais de Chaillot.
Rendez-vous dans cinquante ans
Il est impossible d’évoquer tous les candidats qui auraient mérité le prix Nobel de la paix ; il suffira d’attendre encore 50 ans pour trouver dans les archives du Comité, des noms qui auraient pu devenir ceux des lauréats de cette récompense suprême ! AS♦
 Ada Shlaen, MABATIM.INFO
Ada Shlaen, MABATIM.INFO
[1]Albert Nobel (1833-1896) était un chimiste et surtout un fabricant d’armes. Né en Suède dans une famille de savants et d’industriels, il passa son enfance en Russie où son père a fait fortune. Après de brillantes études aux États-Unis, Albert Nobel continua cette tradition familiale. Durant sa vie, il déposa plus de 350 brevets dont celui de la dynamite. Son immense fortune reposait sur la vente d’armes et surtout sur l’utilisation de la dynamite dans l’industrie et évidemment dans la production d’armes. Considéré comme un « marchand de la mort », il décida d’instaurer des prix pour des chercheurs, des écrivains et des personnalités œuvrant pour le progrès et la paix dans le monde.
[2] L’auteur envoya un télégramme à l’adresse de l’Académie suédoise dans lequel il écrivait : « En vertu de la signification attachée à cette récompense par la société à laquelle j’appartiens, je suis dans l’obligation de la refuser. Je vous prie de ne pas considérer mon refus volontaire comme une insulte. » Le 6 novembre 2019 à 22h55 sur Arte on pouvait voir le film de Nino Kirtadzé Je vous invite à mon exécution, Le dossier « Docteur Jivago ». On pourra le revoir jusqu’au 25 février 2020 sur Arte.tv.
[3] On peut traduire avec un brin de dérision le terme « samizdat » par « autoédition ». Les dissidents d’Europe de l’Est faisaient circuler ainsi dans les années 1950-1980 leurs revendications, et des textes littéraires interdits, tapés à la machine, voire écrits à la main, à l’aide de papier-carbone. Les peines encourues pouvaient être lourdes : emprisonnement dans un camp ou un hôpital psychiatrique. Voilà le témoignage de Vladimir Boukovski : (30.12.1942-27.10.2019) « Samizdat : je l’écris moi-même, je le révise moi-même, je le censure moi-même, je le publie moi-même, je le distribue moi-même et je suis emprisonné pour cela moi-même ».
[4] « Pour la puissance artistique et l’intégrité avec laquelle, dans l’épopée du Don, il a donné une voix à une période historique dans la vie du peuple russe. »
[5] L’académicien Andreï Sakharov (21.5.1921-14.12.1989) a reçu le prix Nobel de la paix en 1975.
[6] FSB = Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie est le successeur du KGB.
[7] Au XIXe siècle, à la suite du partage de la Pologne, ces terres faisaient partie de l’Empire russe.
[8] Balle dum-dum Il s’agit d’une balle de plomb recouverte d’une fine couche de nickel et striée par des petites fentes. Une telle balle provoque beaucoup plus de dommages qu’une balle classique.
[9] https://mabatim.info/2017/08/27/a-la-memoire-de-ludwik-zamenhof-1859-1917/
[10] Voir Philippe Sands, Retour à Lemberg, Albin Michel, 2017
[11] https://mabatim.info/2018/01/10/de-laffaire-dreyfus-a-laffaire-beilis/