
Texte de la conférence « Raison Garder » donnée par G-E Sarfati dimanche 7 mai 2023. Pour visualiser la conférence quand elle sera disponible, rendez-vous ici : Raison Garder – YouTube
1.— INTRODUCTION
Au cours du premier trimestre 2023, un puissant mouvement d’opinion, suscité et organisé depuis les États-Unis par les fractions post-sionistes de la mouvance JCall liée à l’organisation Chalom ah’chav, a pris position contre le projet de réforme de l’appareil judiciaire. Ce fut beaucoup de tapage, mais aussi de cyclones médiatiques, accréditant les plus folles idées. Les différents titres de la grande presse, nationale et internationale, furent mis au diapason d’un même discours, univoque et accusateur, alarmiste et frondeur, définissant à la longue une sorte de credo universel.
Par exemple :
« La réforme de la justice entraîne Israël vers une sortie de la démocratie »,
« Le gouvernement du Premier Ministre Benjamin Netanyahu est le plus à droite de l’histoire d’Israël »,
« La réforme est illibérale, elle menace l’existence de la démocratie »,
et surtout : « La réforme de la justice menace Israël de sombrer dans une théocratie à l’iranienne. »
Notons en passant que les accusations portées contre le gouvernement israélien dans cette conjoncture se développent en osmose avec le discours de l’antisionisme : Israël est montré du doigt, soupçonné d’affirmer une politique exclusiviste, autoritaire, de s’affirmer au mépris des valeurs de progrès et de liberté, de prolonger l’histoire du colonialisme occidental, de promouvoir l’obscurantisme religieux, etc.
Je m’attacherai ici à démontrer que la prétention théocratique est antinomique non seulement avec la tradition du judaïsme historique, mais encore avec les différentes formulations de la philosophie politique du sionisme.
2.— PANORAMA DE L’HORIZON HÉBRAÏQUE AU POINT DE VUE PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE
2.1— L’universalisme hébraïque
La pensée hébraïque pose en principe le seul universalisme authentique : les êtres humains sont tous issus de la même espèce (monogénisme/monanthropisme), bien qu’ils se répartissent en cultures différentes. À cet égard, la tradition juive rabbinique postule que ces différences sont respectables, et ne doivent pas être réduites par la conversion, perçue comme une violence autant qu’une uniformisation. D’emblée, le récit biblique évoque d’abord les lois et principes éthiques communs à tous (les « Lois noahides »), et seulement ensuite, édicte les règles d’éthique qui incombent uniquement aux « enfants d’Israël » (i.e la « Torah »). Cette tradition rompt avec l’esprit de domination1.
En plus d’être différentialiste, l’universalisme hébraïque garantit la singularité, car la liberté et la responsabilité sont au fondement de sa vision de l’Histoire. Cette distinction est reprise dans le Talmud qui parle de l’existence de « 70 nations », dont la tonalité de chacune se reflète dans l’un des « 70 visages d’Israël ».
Nous avons là les bases de la démocratie, et d’une philosophie libérale du consensus et de la conciliation des points de vue divergents. Voilà de quoi immuniser contre l’autocratie, la dictature, exercées au nom d’une humanité supérieure, ou d’une élite.
L’essentiel du message d’Israël tient à cette double singularité. En regard du message d’Israël, l’intolérance, la prétention à dire le vrai de manière univoque, le désir d’universel compris comme uniformisation est une invention des deux monothéismes qui ont affirmé le primat de la conversion (l’Église chrétienne, la Oumma).
Cette tentation autoritaire et liberticide s’est affirmée violemment dès le moment où christianisme et islam se sont appuyés dans leur progression sur des structures impériales et conquérantes. Mais les conceptions d’Israël, et sa longue dispersion ont plutôt inspiré à ses dirigeants comme à ses communautés la recherche de la tolérance et la curiosité pour les méandres de l’âme humaine.
2.2— L’économie de la gouvernementalité dans la Bible hébraïque
La conception hébraïque de la gouvernementalité se déduit de l’idée d’un monde créé par un dieu qui – pour permettre à ses créatures de se développer et d’exister – a renoncé à une partie de sa toute puissance et de son omniprésence.
Cette figure du « retrait de Dieu » est le modèle même de la relation à autrui, telle que la conçoivent et l’hébraïsme et le judaïsme : ce schéma notionnel est par conséquent foncièrement allergique à l’esprit de domination, ou d’intolérance, puisque la socialité suppose la reconnaissance de la différence spécifique et le respect de son droit (cette idée définit pour le judaïsme la « source du droit naturel »).
Il est admis que le judaïsme est un humanisme2. Mais à la vérité, il se distingue de l’humanisme grec ou latin, parce que l’homme n’est pas un fruit de la nature, mais une expression de la libre volonté divine. En ce sens exact, le judaïsme est donc un humanisme théocentriste, l’homme y est justifié en face de Dieu, dans sa singularité irréductible.
L’histoire de la sortie d’Égypte est le plus fort marqueur de la politique juive, qui est d’abord arrachement à l’esclavage et acceptation d’une loi qui fonde la liberté humaine à partir de la responsabilité.
Là encore, si le thème de la dictature est à l’ordre du jour, il se développe en étant profondément associé à la figure de Pharaon, qui est la figure même du tyran théocratique (il est le fils du Soleil). Rien de tel dans le Judaïsme où le postulat de la présence du Très Haut met en demeure les dirigeants de se garder toujours d’une rechute dans l’esclavage (je vous renvoie ici aux différents épisodes de la nostalgie de l’Égypte).
Cette vigilance constitue une constante de la pensée juive, elle s’est vérifiée et s’est confirmée à chaque étape de l’histoire d’Israël :
(1). Après l’époque patriarcale, les enfants d’Israël deviennent un peuple-nation, en recevant leur constitution sur le Mont Sinaï, constitution d’emblée transmise à tous et d’emblée appelée à l’interprétation (ce qui évite la clôture du sens : le prophète et le prêtre (Moïse/Aaron) s’appuieront bientôt sur des Juges, puis des Rois : ceux-ci ne gouverneront pas au nom de Dieu, mais seront les garants de la loi de Dieu.
(2). Dans le judaïsme antique, c’est la fédération administrative des Tribus d’Israël qui fonde l’exercice de l’autorité : s’y ajoutent la concertation permanente, la délégation, le débat qui préside aux grandes comme aux petites décisions.
(3). À l’époque monarchique, et même au-delà du schisme entre le Nord et le Sud (Royaume de Juda/Royaume d’Israël), l’exercice du pouvoir repose sur la coopération de 3 instances : le roi (exécutif), le prêtre (judiciaire), le prophète (législatif, en prise sur les circonstances), qui agissent en vue du peuple, lequel en dernière analyse est le véritable juge.
2.3— Le gouvernement d’Israël en Exil
Israël a connu deux exils : celui de Babylone, et celui de Rome. La Bible témoigne de ce que fut l’organisation du pouvoir au retour de Babylone. Dépourvu de souveraineté, Israël n’eut pas à assumer de fonction politique ni militaire, et le judaïsme que nous connaissons s’est forgé dans ce moment (à l’époque perse, i.e principalement au 6ᵉ siècle avant notre ère) : Celui-ci se caractérise par la centralité de la Torah, à travers sa lecture et sa traduction publique, l’action des gouverneurs, et l’activité des derniers prophètes. Le triptyque du pouvoir se maintient : le souverain (gouverneur laïc : Néhémia), le prêtre enseignant (Ezra), le prophète (Hagaï, Malachie, Zacharie – au 4ᵉ s. av. notre ère. Les prophètes proclament encore le Retour et la répartition conjointe du pouvoir avec les descendants de la lignée du Grand prêtre et ceux de la lignée des Rois. Différenciation des instances donc.
Entre le 2ᵉ siècle av . EC et le 1ᵉʳ s. de notre ère, Israël a de nouveau connu une restauration de sa souveraineté : c’est l’épisode du royaume hasmonéen – Mamlekhet hahashmonayim, entre 140 ec et 37 ec –, caractéristique du judaïsme du deuxième Temple. Ce retournement de situation est consécutif à la révolte des Maccabim qui surent fédérer la Judée contre les Séleucides. La victoire initiale permit l’inauguration du Temple par Judah Maccabi, en -162, évènement symbolisé par la fête de Hanukah).
Mais le successeur de Judah, son frère Simon Maccabi (142-135) cumule les fonctions d’ethnarque à perpétuité (hérédité de la charge), de grand prêtre et de chef militaire3. C’est un cas unique dans les annales des rois d’Israël, violemment critiqué par la tradition rabbinique, pour avoir instauré en Judée les mœurs politiques des souverains païens.
Ce coup de force provoque un puissant rejet dans le peuple, et suscite, chez les Sages du Talmud, une critique qui a fait date : la plus grande transgression commise par ces souverains a consisté à s’arroger la fonction de grand prêtre.
Du reste, nous savons aujourd’hui, par le témoignage des Manuscrits de la Mer Morte, en particulier par l’analyse des « textes sectaires » (« Esséniens ») que la position des rois hasmonéens a été à l’origine d’un schisme sociologique et théologique radical. Ces textes parlent du « prêtre impie » qui règne à Jérusalem, de ses abus de pouvoir, et la nouvelle communauté qui commence alors à faire souche dans la région de Qumran (la Mer morte et ses alentours) pose les bases d’une nouvelle organisation communautaire, qui reconstitue le « triptyque des instances » : des juges laïcs, une administration laïque, et un groupe de prêtres, chaque instance ayant son rôle, avec interdiction stricte pour chacune d’empiéter sur le domaine des deux autres.
J’attire votre attention sur l’étonnant parallèle qui peut être ici établi entre cette époque et la nôtre : au fil du temps, les Hasmonéens sont devenus des rois-collaborateurs, agissant sous l’influence des Romains, et le peuple est divisé. La Judée est traversée par de retentissants conflits idéologiques, comme elle le fut peu avant au contact de la civilisation hellénique.
2.4— Le second exil et le développement du judaïsme talmudique
La décadence hasmonéenne culmine avec le début de la domination romaine. Dans ce contexte trouble, le judaïsme antique connaît un nouveau processus de différenciation : les Sadducéens, en charge du Temple, penchent du côté des occupants, les Zélotes (ou les Sicaires) prennent le parti de la résistance armée, les Esséniens rompent avec les rois félons et font sécession dans le désert de Judée, tandis que le parti des Pharisiens, pressentant l’ampleur des bouleversements qui s’annoncent s’efforcent de maintenir la cohésion du peuple au profit d’une démocratisation du savoir.
C’est eux qui auront raison, ils sont les seuls survivants de cette époque, les artisans de la pérennité du judaïsme. Dans ce contexte de perte de la souveraineté politique, de destruction des institutions ainsi que de sa base territoriale, avec les Pharisiens, le peuple d’Israël (Judéens) invente de nouveaux modes de survie collective, et pose les bases d’une conception démocratique de la vie collective.
La période talmudique, qui débute au 2ᵉ siècle de l’EC assigne deux principes intangibles à la vie collective du peuple juif en exil :
(1). D’abord, un principe politique qui fait prévaloir la nécessité de l’adaptation à un environnement généralement hostile. Ce principe tient dans la formule araméenne : dina de malkhuta dina, qui veut dire : « la loi du royaume est la loi » (sous entendu : aussi longtemps qu’elle ne porte pas atteinte à la loi d’Israël). Dans ce contexte, la « politique du peuple juif » consiste à accepter la règle du pays de résidence de chaque communauté. Ce principe a rencontré sa limite positive dans la résistance héroïque que les communautés juives persécutées opposèrent aux tentatives violentes de conversions forcées. Ainsi, c’est au Moyen Âge, au moment des Croisades, que l’éthique de la Sanctification du Nom (kiddush Hachem) fut définie.
(2). Ensuite un principe de transmissionqui fait prévaloir l’importance de l’éducation, et de l’enseignement dialectique du patrimoine le plus ancien. Ce corpus se trouve d’abord consigné dans les 6 Ordres de la Mishna avec ses 63 Traités (Talmud de Babylone et Talmud de Jérusalem). Au fil des siècles, ses contenus spirituels, théologiques, légaux, littéraires, philosophiques, scientifiques donneront lieu à d’importantes extensions, et ceci jusqu’à notre époque (le Tanakh et ses exégèses, mais aussi les commentaires du Talmud/Tossefta ; les collections de midrash, les œuvres philosophiques, les différentes écoles de la kabbale, etc.).
A travers le monde, les communautés juives s’organisent dans le cadre des « quatre coudées de la Torah » (expression des Pirké Avot), jusqu’au 10ᵉ siècle, elles sont régies par des Exilarques (les « Princes de l’exil », en particulier les « Geonim » de Babylone). Ceux-ci ne sont ni des rois ni des prêtres, mais des érudits investis d’une responsabilité administrative collective. La tradition du Sage et du Conseiller apparaît dans ce contexte.
Le peuple juif en exil, se reconnaît alors à deux caractéristiques doctrinales :
(1). D’abord l’espérance du Retour. Mais Israël a perdu toute attache avec la dimension politique de la souveraineté, ce qui fait que cette espérance du Retour consiste surtout dans une métaphorisation et une idéalisation de la restauration de « la monarchie de David » (ceci représente le point de départ de l’espérance messianique) ;
(2). La 2ᵉ caractéristique d’Israël en exil est une situation d’éclatement sociologique et géographique, qui cultive, à travers l’attente messianique, la valorisation de l’étude (telle sera la dynamique de la diaspora pendant 18 siècles, jusqu’à l’Émancipation).
Dans cette configuration, pour Israël qui aspire de nouveau à la rédemption et à la libération, la dimension politique reste à réinventer. L’évolution de la Halakha et de ses différentes codifications témoignent éloquemment de cette transformation : alors que le Mishné Torah de Maïmonide – composé au 12ᵉ siècle – envisage la codification de tous les secteurs de l’existence et de la vie collective (ce qui inclut la question de l’État et du gouvernement), le Shulkhan Aroukh de Joseph Caro – composé au 16ᵉ s.- et la Mishna Brura de Méir Kogan haCohen (le Hafets Haïm) – composé dans la seconde moitié du 19ᵉ s.- limitent tous deux la codification halakhique à la réglementation de la sphère privée, des lois du commerce, et des lois liturgiques. Cela indique bien qu’Israël a renoncé à penser le politique en fonction de ce que l’on appelle – d’un mot très impropre – « la religion ».
Je dis cela ainsi, par ce que depuis l’époque talmudique qui a vu les différentes écoles exégétiques et juridiques rivaliser entre elles, la culture juive s’est imposée à toutes les communautés diasporiques comme une culture du débat contradictoire – et plus spécifiquement comme ce que le philosophe du judaïsme Moshé Halbertal Bartal appelle « une culture de la controverse »4.
Là encore rien de monolithique, rien d’une propension à la dictature (de l’ordre de l’autocratie vs de la théocratie) : Force est d’admettre que ce sont plutôt les contextes politiques dans lesquels évolue la diaspora qui sont de cette nature). G-ES♦

Georges-Elia Sarfati, MABATIM.INFO
Philosophe, linguiste, psychanalyste, traducteur.
Directeur de l’Université Populaire de Jérusalem. Docteur en études hébraïques et juives
À suivre :
Israël, la réforme judiciaire et le fantasme de la théocratie 2/3
Israël, la réforme judiciaire et le fantasme de la théocratie 3/3
1 Voir l’étude d’Ivan Segré : La souveraineté adamique, Paris, Ed. Amsterdam, 2022.
2 Voir l’essai quasi éponyme de S. Trigano : Le monothéisme est un humanisme, Paris, Ed. Odile Jacob, 2000.
3 L’histoire des monarques hasmonéens se prolonge jusqu’à la conquête romaine de la Judée. Dans l’ordre, voici les noms des différents rois de cette lignée. Après Simon, vinrent Jean Hyrcan, Aristobule 1ᵉʳ, Alexandra Jannée, Salomé Alexandra, Hyrcan II et Aristobule II, Antigone II Matthatias, jusqu’à la prise de pouvoir d’Hérode.
4 Voir de cet auteur : Le peuple du Livre. Canon, sens et autorité, Ed. In Press, Paris, 2005.
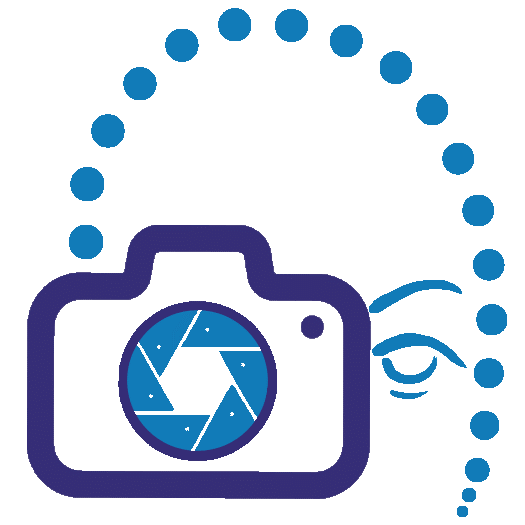

[…] de ces héritiers d’une tradition d’étude qui remonte à l’origine même du peuple hébreu (cf la Conférence de G-E Sarfati du 7 Mai), n’aurions-nous pas une dette, immense, puisqu’elle a assurément permis la persistance du fait […]
J’aimeJ’aime
[…] conférence quand elle sera disponible, rendez‑vous ici : Raison Garder – YouTube.– Première partie ici– Deuxième partie […]
J’aimeJ’aime
[…] Texte de la conférence « Raison Garder » donnée par G-E Sarfati dimanche 7 mai 2023. Pour visualiser la conférence quand elle sera disponible, rendez‑vous ici : Raison Garder – YouTube.– Première partie ici […]
J’aimeJ’aime
Merci pour cet article très intéressant.
J’aimeJ’aime
Brillant article comme souvent sur ce site. Je trouve rassurant de retrouver cette cuture de la réflexion et de la controverse, ainsi que la méfiance envers le mot « religion » pour désigner le judaïsme. Une remarque simplement : De Machiavel à Staline, il est enseigné à peu près ceci : « attaquez et pendant que votre interlocuteur se justifie, avancez d’un pas ». A court terme, cela marche souvent. A long terme, cette dialectique s’effondre, mais hélas, aussitôt remplacée par une autre, tout aussi efficace car la génération montante a déjà tout oublié. Le Peuple du Livre et la Mémoire a encore beaucoup de travail.
J’aimeJ’aime